Accueil → Analyse → Culture → Le Japonais Hokusai et le réalisme en perspective
En juillet 1853, le commandant de marine américain Matthew Perry débarqua avec plusieurs navires sur les côtes japonaises et exigea d’être reçu par le gouvernement, ce qui fut fait. Il réitéra en février 1854 pour exiger l’ouverture de l’économie japonaise, avec différents traités, ce qui fut obtenu, aboutissant à l’effondrement du pouvoir en place qui maintenait jusque-là le Japon dans l’isolement international.
Ce furent alors les grands propriétaires terriens et les grands capitalistes qui prirent le pouvoir au Japon, l’empereur étant leur représentant, amenant le pays, majoritairement agricole et arriéré, à voir émerger toute une frange capitaliste monopoliste immédiatement tourné vers le militarisme.
Cette ouverture internationale du Japon eut un grand retentissement culturel, avec notamment la diffusion des estampes, notamment de Katsushika Hokusai, et du style japonais dans les meubles ou encore certains petits objets comme les vases, les tasses, les sabres, les éventails, les ombrelles, etc.
Cela produisit un phénomène appelé le japonisme, particulièrement fort en France, pays qui signa un traité commercial avec le Japon en 1848, alors que ce pays fut présent à l’exposition universelle de Paris de 1867.
Une figure majeure ici fut le capitaliste allemand Siegfried Bing (1838-1905), qui ouvrit une boutique à Paris, dont l’une des expressions fut la revue Le Japon artistique, documents d’art et d’industrie ; il faut également mentionner un Japonais, Hayashi Tadamasa, qui possédait également une boutique parisienne.

Il faut souligner le double caractère du japonisme. D’un côté, c’est une simple consommation exotique pour une bourgeoisie aisée cherchant des motifs pour être remarquée, ainsi qu’une fascination cosmopolite pour des « artistes » prétendant trouver de nouvelles voies pour l’art et ainsi surtout faire carrière.
On a pour ce dernier point un paradoxe historique où le subjectivisme d’une bourgeoisie développée prend l’art d’une bourgeoisie émergente pour insister sur ses faiblesses afin de rejeter le réalisme.
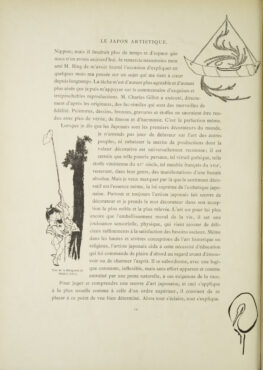
De l’autre il y a une vraie curiosité à la fois internationaliste et productive, lié à l’existence encore relativement forte d’artisans liés à la création industrielle. C’est une rencontre produite par l’accroissement des forces productives.
On lit ainsi dans le premier numéro de la revue Le Japon artistique, documents d’art et d’industrie, dans l’article introductif :
« Elle [cette publication] s’adresse tout particulièrement aux nombreuses personnes qui, à un titre quelconque, s’intéressent à l’avenir de nos arts industriels, à vous notamment, ouvriers modestes ou grands manufacturiers, qui avez un rôle actif dans cette partie de notre force productive.
Dans les nouvelles formules d’art qui nous sont venues de la côte la plus extrême de l’Extrême-Orient, nous avons en effet à chercher quelque chose de plus qu’un régal platonique pour nos dilettantes d’humeur contemplative.
Nous y trouverons des exemples dignes à tous égards d’être suivis, non certes pour ébranler les bases de notre vieil édifice esthétique, mais pour venir ajouter une force de plus à toutes celles que depuis des siècles nous nous sommes appropriées pour en étayer notre génie national. »
Il s’agit pour la revue de présenter
« tour à tour des paysages vaporeux et des études de fleurs ou d’oiseaux, des scènes de vie populaire, et jusqu’aux types étranges de la comédie mystique dont les masques expressifs ne le cèdent en rien à leurs congénères de la Grèce antique. »
Le public visé est défini comme suit :
« L’Amateur spécial et l’artiste,
L’industriel et l’artisan,
L’Homme du monde que séduit toute production élégante de l’art »
C’est là d’un côté une approche nullement cosmopolite, mais bien au contraire allant dans le sens de la synthèse et on doit y voir ici une tendance strictement parallèle à l’art nouveau viennois, avec son souci d’esthétiser la vie quotidienne, en cherchant à s’appuyer sur une partie de la bourgeoisie encore industrieuse et cultivée.
C’est de l’autre côté une lecture cosmopolite visant à ouvrir des perspectives en apparence, mais en réalité à pratiquer la liquidation du réalisme au nom de la « modernité ». On a ici affaire à l’impressionnisme. On a ainsi Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec… qui collectionnaient les estampes japonaises, Vincent Van Gogh prétendait s’inspirer de l’art japonais, etc.

Vincent Van Gogh : La Courtisane (d’après Keisai Eisen), 1887 ; Pruniers en fleurs (d’après Hiroshige), 1887 ; Père Tanguy, 1887
Ainsi, au-delà de l’inspiration, le japonisme apparaît comme l’idéologie d’une sorte d’utopie artistico-bourgeoise, porté par des artistes et intellectuels se reconnaissant de fait sans le savoir dans l’art japonais une bourgeoisie émergente et s’élançant, dont on pourrait en quelque sorte happer les forces historiques.
Le compromis historique fantasmé entre esthétisme et capitalisme qu’on trouve ici à l’arrière-plan se résume parfaitement dans la formule comme quoi les Japonais seraient « les premiers décorateurs du monde » : l’art appliqué, en tant que décoration, est dans ce cadre un savant équilibre entre une activité artistique réelle et une consommation bourgeoise.
De manière idéaliste, la bourgeoisie japonaise émergente proposant une activité réaliste de conquête du monde artistique japonais est « oubliée » et l’art japonais idéalisé est interprété comme une conception universelle d’embellissement de la vie quotidienne.
Le caractère idéaliste de cette lecture se révéla rapidement avec l’oubli complet de cette question esthétique pour un japonisme se réduisant entièrement à une consommation chic de la bourgeoisie parisienne et à un prétexte pour un renforcement de l’affirmation subjectiviste de l’impressionnisme en peinture.