Chère Fay,
Pour des raisons évidentes, il me répugne de m’appesantir sur le passé. En tant qu’individu, qu’homme de notre race, je n’ai à présenter que la cicatrice enflammée qu’ont laissée ces dernières années comme preuve que je ne suis pas mort du mal qui nous a terrassés si longtemps. J’ai écouté la leçon du passé et j’ai tenté de le clore.
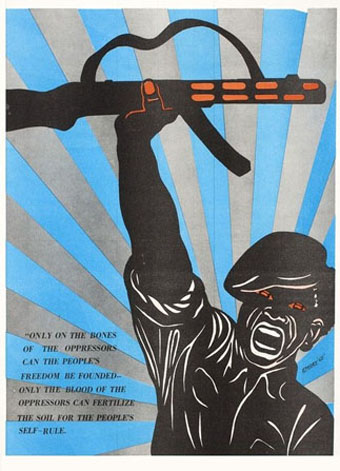
J’ai bu une fameuse gorgée de fiel, j’ai nagé à contre-courant, connu les rues sanglantes des cités fascistes d’Amérika. On m’a mis le nez dans la merde. La haine dont je me suis armé est immense. J’ai essayé d’oublier, de faire semblant.
Mécanisme de défense classique chez l’homme noir. En vain. Peut-être suis-je seul à réagir ainsi, mais je soupçonne que c’est plutôt notre pitoyable condition qui fait que les moments les plus durs se fixent dans notre esprit avec clarté et pour toujours, tandis que les éclairs de joie se perdent immédiatement parce que le cauchemar les recouvre de son ombre.
Nous entendons ici des conversations détendues, banales, sur la question de savoir dans quel ordre il faut tuer tous les nègres de ce pays et par quels moyens. Ce qui me dérange, ce n’est pas qu’ils envisagent de me tuer ; ça fait bientôt cinq siècles qu’ils « tuent tous les nègres », et je suis encore vivant. Je dois être le mort le plus récalcitrant de l’univers. Non, ce qui me gêne c’est que, dans leurs plans, ils n’imaginent pas une seconde que je vais me défendre. Est-ce qu’ils croient vraiment cette connerie ?
C’est ce que je me demande. Oui, ils le croient. Ils pensent qu’ils ont anéanti tous nos réflexes d’attaque et de défense, qu’ils nous ont rendus complètement inoffensifs. Qu’il nous manque cette partie de la tête où les hommes puisent leur combativité. Est-ce qu’ils ne parlent pas des camps de concentration ? Ne disent-ils pas que jamais une telle chose ne pourrait se produire aux États-Unis parce qu’ici les fascistes sont gentils. Non parce qu’il est impossible d’incarcérer trente millions de résistants, mais parce que les Américains sont des impérialistes humains, des nazis éclairés.
Eh bien, ils ont commis une grave erreur. Je me rappelle le jour de ma naissance, le premier jour de ma vie. C’était pendant la deuxième (et la plus destructrice) des guerres mondiales, par un mercredi pluvieux de septembre, le matin à Chicago. Ça m’est arrivé dans un petit lit pliant, dans le demi-appartement que nous occupions au coin de la rue Racine et de la rue Lake. Le docteur Rogers était là. Le métro aérien qui passait à cinq mètres de nos fenêtres (des deux seules fenêtres que nous avions) hurlait à la souffrance et à la mort, présage menaçant. Le premier mouvement que mes yeux ont pu fixer, c’était celui de cette main blanche se balançant en direction de mon derrière noir. J’ai arrêté cette main dans son mouvement, j’ai riposté d’un coup à la face. Je suis né avec de bons réflexes de défense. Ça va être : « Tue-moi si tu peux, imbécile », et non : « Tuez-moi, je vous en prie. »
Qu’ils essaient de compter sur le principe « tel esclave, tel fils » ! Ça ne marche pas avec moi ; ils m’ont rendu la riposte plus facile. Si un flic donnait les clés à un groupe de détenus de droite, ils ouvriraient nos cellules une à une, dans tout le bâtiment. Ils ne chercheraient pas à s’échapper ou à faire leur affaire à ceux qui nous gardent ici. Ils ne pourraient résoudre leurs problèmes qu’en nous tuant tous. Pensez un peu à cela : ces types vivent à quelques cellules de la mienne.
Aucun d’eux n’a jamais vraiment vécu, la plupart d’entre eux sont « entretenus » par l’État dans des établissements comme celui-ci ; ils n’ont aucun avenir, rien à attendre du présent. Quand ils défendent des idées de droite et le statu quo, ils veulent sans doute dire que 99 années « à l’ombre » est l’idée qu’ils se font de la belle vie. Ils passent leur temps à se faire arrêter et à sortir, mais ils sont le plus souvent en prison. Les périodes qu’ils passent dehors sont considérées comme des « balades », et celles qu’ils passent en tôle leur paraissent plus naturelles, plus conformes à leurs goûts. Je comprends leur condition, et je sais comment ils en sont arrivés là ; je pourrais même sympathiser honnêtement avec eux, s’ils n’étaient pas assez stupides pour laisser les flics se servir d’eux contre nous. Pour moi, ils ressemblent aux Allemands des années 30 et 40.
Et c’est pareil au-dehors ; je suis sûr que dans les familles des flics qui ont assassiné Fred Hampton, personne ne possédait de valeurs ou d’actions. Ils organisent dans tout le pays des marches et des manifestations en faveur de la destruction totale et immédiate du Vietnam ; et après, personne n’est capable de payer la note. Les fascistes ont, semble-t-il, une tactique type à l’égard des classes inférieures, et c’est la même dans toute l’histoire de l’oppression.
Ils dressent l’homme contre lui-même. Pensez à toutes les petites satisfactions avec lesquelles on peut nous acheter, pensez comme les plus défavorisés s’en remettent au Pouvoir, pensez au détenu coupable d’un crime « capital » et partisan de la peine de mort ! Je jure avoir entendu quelque chose de comparable aujourd’hui même !
Voyez combien de temps Hershey est resté à la tête des services de conscription. Les Noirs se rallient au capitalisme ! Voilà l’exemple le plus extraordinaire, le plus contre-nature que l’histoire puisse nous offrir de l’homme en lutte contre lui-même. Après la guerre de Sécession, la forme d’esclavage a changé : nous sommes passés de l’état de cheptel à l’esclavage économique ; nous avons été jetés sur le marché du travail, mis en compétition avec les blancs pauvres dans des conditions désastreuses pour nous ; depuis ce moment-là, notre principal ennemi peut être défini et identifié comme le capitalisme.
L’esclavagiste était et reste le patron de l’usine, l’homme d’affaires, le responsable de l’emploi, des salaires, des prix, des institutions et de la culture nationale. C’est l’infrastructure capitaliste de l’Europe et des États-Unis qui est responsable du viol de l’Afrique et de l’Asie. Le capitalisme a assassiné trente millions d’hommes au Congo. Croyez-moi, ils n’auraient pas gâché toutes ces balles, si ça ne leur avait pas rapporté quelque chose ! Tous ces hommes qui sont allés en Afrique et en Asie, ces parasites meurtriers qui se sont abattus sur le dos de l’éléphant, n’ayant en tête que le mal, méritent bien les insultes qu’on peut leur adresser. La mort n’est que la juste rétribution de leurs crimes.
Mais nous ne devons pas laisser les émotions nous envahir, l’écume de la surface brouiller l’image d’ensemble. C’est le capitalisme qui a armé les navires, la libre entreprise qui les a lancés, la propriété privée qui a nourri les troupes. L’impérialisme a repris la situation là où la Traite l’avait laissée. C’est seulement après la fin de la Traite que l’Amérique, l’Angleterre, la France et les Pays-Bas ont envahi et occupé pour de bon, les terres d’Afrique et d’Asie. A mesure que la révolution industrielle s’affirmait, de nouveaux objectifs économiques remplaçaient les anciens ; l’esclavage des plantations faisait place à un néo-esclavage. Le capitalisme armait les navires et ravitaillait les troupes. Il va de soi que c’était l’appât du gain qui l’attirait.
C’est lui qui construit les clapiers dans lesquels on nous fait vivre. Le profit interdit réparations et entretien. La libre entreprise a amené dans nos quartiers ses chaînes de magasins à monopole. La propriété privée a installé dans nos rues et nos maisons des légions de flics stupides à la détente facile. Ils sont là pour protéger l’entrepreneur, « sa » chaîne de magasins, « sa » banque, « ses » immeubles. Si l’homme d’affaires décidait qu’il ne veut plus nous vendre de nourriture parce que, supposons, le dollar yankee, que nous chérissons tant, a tout à coup perdu ses derniers trente sous de pouvoir d’achat, la seule manière pour le peuple de manger serait d’enfreindre la loi.
Ce gros cochon de Daley [Maire de Chicago] a donné l’ordre de descendre tous les pillards. Le capitalisme noir, c’est le Noir contre lui-même. La contradiction la plus absurde d’une longue série d’abandons et de folies. Un autre remède sans douleur de dernière extrémité : être plus fasciste que le fasciste lui-même. Sylvester Brown est prêt à mourir, ou à voir mourir nos fils, pour des contrats de balayeur.
Bill Cosby [Comédien noir qui joue le rôle d’un agent secret dans un feuilleton d’espionnage à la T.V. aux côtés d’un acteur blanc. C’est généralement le Blanc qui l’emporte et c’est toujours le Blanc qui gagne le cœur de la fille blanche à la fin de l’histoire] joue un rôle d’espion fasciste ; quel message apporte-t-il à nos fils ? un message infantile ! Ce méprisable individu et son acolyte leur enseignent le credo de l’esclave, la version « nouvelle vague » du vieux serviteur nègre. Nous ne pourrons avoir confiance tant qu’il y aura des gens comme ça. Ils font partie de la répression autant, si ce n’est plus, que le vrai flic. Ne disent-ils pas à nos enfants qu’il est romantique d’être un chien couchant ? Les gosses sont si contents de voir un Noir tirer et se battre qu’ils ne peuvent s’empêcher de s’identifier à ce collaborateur de l’ennemi. Le fasciste s’empare de tous les facteurs latents de division et les met en action : racisme, nationalisme, religion.
Il y a le « rital », l’« hidalgo », le « youpin », le « chinetoque », le « jap », etc., le fait qu’il est beaucoup plus facile de persuader le petit soldat qui s’est engagé « pour voir le monde » et qui n’a jamais tué personne d’assassiner un « gook » [terme d’argot raciste, désignant les Vietnamiens] : ce n’est pas tout à fait comme de tuer un homme. Polack, mangeur de grenouilles, de choucroute, etc.
Ça ne marche plus depuis les années 30. Certains préféreraient l’oublier et toute référence à cette période suscite les épithètes défensives de « dépassé », de « socialisme simpliste ancien style », de « démodé », mais je me fiche de la mode. Je cherche les faits. Et le fait est que personne, absolument personne dans le monde occidental, et très peu ailleurs (y compris ceux qui naissent aujourd’hui), n’a été épargné le jour où la roulette capitaliste s’est bloquée dans la Dépression. Toutes les nations du monde ont été touchées.
La Russie n’avait, bien sûr, pas de Bourse et par conséquent était en dehors de ce cycle économique. Mais elle a été touchée par la guerre qui est sortie des efforts pour remettre la machine en marche, et des effets que la Dépression a eus sur les autres nations auxquelles elle avait affaire. Le phénomène s’est répercuté. Comme le capitalisme international était alors à son apogée, il n’y a pas eu de nation africaine, américaine ou latine qui n’ait subi les conséquences de la Dépression.
Toute société possédant une économie monétaire a été entraînée dans la crise. Bien que la Russie ait rejeté le système capitaliste et ses soubresauts, elle aussi a souffert des répercussions de la crise. Si l’on se demande si ces années ont eu le moindre effet sur ce qui se passe actuellement, ont le moindre rapport avec le présent, que l’on considère leurs conséquences sur la mentalité d’aujourd’hui.
Si tous les peuples du monde avaient été frappés de « crétinisme héréditaire » au lieu de l’être par la « main invisible » d’Adam Smith, ce serait exactement pareil. Et j’entends crétinisme dans son sens littéral, médical : une déficience congénitale des sécrétions de la glande thyroïde provoquant difformité et idiotie. Il y a un lien de cause à effet entre la Dépression et la Seconde Guerre mondiale. On peut attribuer la montée du nazisme en Europe à la Dépression. Les W.A.S.P. fascistes d’Amérique désiraient secrètement une guerre avec le Japon pour stimuler l’industrie et enrayer le chômage. Le syllogisme s’enchaîne.
Analysez l’état où se trouvent les juifs d’Europe, ceux qui ont survécu. Faites pareil avec les habitants d’Hiroshima et de Nagasaki. Mais point n’est besoin de considérer des groupes isolés. Personne n’échappe au passé. Aucun juste ne serait vivant aujourd’hui si ses parents étaient morts de misère à cette époque ou s’ils avaient succombé au piège fasciste détournant la classe ouvrière de la réalité de la lutte des classes. Les nazis avaient réussi à faire avaler aux classes pauvres d’Allemagne et à certains autres groupes en Europe, l’idée que leurs difficultés ne venaient pas de mauvais principes économiques mais étaient causés par l’existence des juifs à l’intérieur du système et par le manque de débouchés (colonies).
Leur intention évidente était de dresser les Allemands pauvres contre la classe défavorisée juive, au lieu que ce soit exploités contre exploiteurs. Le fascisme américain s’est servi de mille procédés comparables, de manœuvres de temporisation, pour empêcher le peuple de mettre en question la validité des principes du capitalisme, pour dresser le peuple contre lui-même ou contre d’autres peuples. Ils font régner entre nous la compétition (quand eux-mêmes coopèrent) la division, la méfiance ; ils nous isolent.
Les antipodes de l’amour. La méthode du fascisme est de protéger le capitalisme en détruisant conscience, unité, confiance, chez les classes pauvres. Mon père a la quarantaine. Il a vécu, il y a trente-cinq ans, ses années les plus formatrices. Il était un enfant de la « grande Dépression ». Remarquez, pour plus de précision, que je distingue la « grande Dépression » des autres. Il y en a eu bien d’autres, nationales, internationales, et régionales pendant la période de l’histoire dont je parle dans cet exposé. Il y a des millions de Noirs encore vivants, de la génération de mon père. Ils sont tous issus d’un milieu complètement bouleversé par la Dépression.
Toute leur vie ils ont vécu dans une insécurité terrible. Aucun d’eux n’a su comprendre quelle détérioration infâme avait subi leur personnalité du fait de ce sentiment morbide de manque économique. Mon père a acquis son caractère, ses habitudes, ses convictions, sa personnalité, son style de vie, au sein d’une situation qui a commencé par la fuite de sa mère. Elle l’a abandonné avec son frère aîné, au bord d’un ruisseau, à l’est de Saint-Louis. Ils se sont élevés tout seuls dans les rues, dans une ferme, quelque part en Louisiane, dans des camps de travail. Mon père n’a reçu aucune éducation normale. Il a appris l’essentiel par lui-même, plus tard. Seul, dans la jungle la plus hostile du monde, livré aux lions et promis à une mort lente et sanglante.
Seul pendant la période la plus sauvage de l’histoire, sans armes et affligé d’une peau noire qu’il cache depuis ce temps-là. J’aime ce frère, mon père, et quand je me sers du mot « amour » ce n’est pas pour m’essayer à la rhétorique. Je cherche à exprimer ce sentiment lumineux, irrépressible, qui émane de la région la plus profonde et la plus durable de mon âme − une chose inébranlable que je n’ai jamais mise en question.
Mais personne ne peut survivre à ses épreuves sans en rester marqué. La santé mentale a été le prix de la survie. J’irai même jusqu’à dire qu’il n’y a pas un seul Noir de cette génération qui soit resté sain d’esprit – pas un. Mon père a atteint l’âge mûr sans jamais manifester en ma présence, ni nulle part à ma connaissance, la moindre trace de sensibilité vraie, d’affection ou de sentiment. Toute sa vie il a vécu sous le choc. Rien ne peut le toucher, son calme est parfait, il est totalement immunisé contre la douleur. Quand je peux rencontrer son regard, ce qui est rare, car s’ils ne sont pas fermés, ses yeux sont comme voilés, j’ai devant moi le masque inexpressif du Zombie.
Il nous a très certainement aimés, j’en suis sûr. Il est de règle chez le « néo-esclave », chez l’esclave d’hier, aujourd’hui libre de se déplacer s’il en trouve les moyens, de se tirer sur la pointe des pieds des situations trop difficiles. Lui est resté avec nous. Il a travaillé seize heures par jour après lesquelles il mangeait, se lavait et dormait. Point. Il n’a jamais possédé plus de deux paires de chaussures, et du temps où je vivais avec lui, jamais plus d’un costume. Il n’a jamais bu, jamais mis les pieds dans un bar, n’a jamais parlé de ces choses. Il ne nous a jamais fait remarquer qu’il nous consacrait toute la force vitale et l’activité que le monstre-machine lui laissait.
La partie que la machine lui a ravie, l’esprit tué par un monde qu’il n’avait pas fait, nous en avons porté le deuil, surtout moi ; mais aucun d’entre nous n’a jamais vraiment essayé de le consoler. Comment consoler un homme qu’on ne peut atteindre ?
Il est venu me voir quand j’étais à San Quentin. Il avait dans les quarante ans, un âge où les hommes sont dans leur pleine maturité. J’avais décidé de le toucher, de le forcer, par ma dialectique révolutionnaire, à ébranler quelques-unes des barricades mentales qu’il avait dressées pour protéger son corps d’un ennemi pour lui indéfinissable et omniprésent. Un ennemi qui pouvait affamer son corps, l’exposer aux éléments, le mettre en prison, le matraquer, le pendre, l’électrocuter, le passer à la chambre à gaz. Je voulais qu’il comprenne que, s’il avait sauvé son corps, c’était au prix terrible de son âme. J’avais le sentiment que si je pouvais faire accepter à ce qu’il lui restait d’esprit la doctrine explosive de l’autodétermination par un gouvernement populaire et une culture révolutionnaire, si je pouvais l’exposer à la catharsis révolutionnaire de Fanon, je le servirais lui, je servirais le peuple et l’histoire.
C’était à San Quentin la saison des émeutes. Au début de janvier 1967. Les flics étaient depuis trois mois en plein délire de fouilles et de destruction. A toute heure du jour ou de la nuit, nos cellules étaient envahies par des escadrons de brutes : vous êtes réveillé, battu, déshabillé, fouillé et vous attendez tout nu dehors pendant qu’ils éparpillent vos quelques rares effets personnels. Ce traitement, la thérapie par la peur, n’était cependant pas appliqué à tous : seulement à quelques Chicanos, soupçonnés du trafic de drogue, à quelques Blancs accusés d’extorquer de l’argent aux autres, mais surtout aux Noirs.
Question de principe. La Réhabilitation par la terreur. Chaque nouveau flic doit accomplir une période d’entraînement au service actif, où il apprend les techniques de la Gestapo : toute la série des tactiques de lutte dont il devra se servir dans son travail. Une partie de son entraînement consiste dans un cours de « close combat », il apprend le maniement de la matraque et les prises les plus simples du karaté : quelle est la manière la plus « efficace » de frapper un homme. Les nouvelles recrues doivent faire une sorte de stage dans ces escadrons avant de prendre leur poste régulier dans la ménagerie.
Ils ont toujours hâte d’utiliser leurs nouveaux talents, de « voir si ça marche vraiment ». Nous sommes forcés de faire quelque chose pour les freiner. Les « frères » essaient de protester. Habituellement c’est par la grève, l’arrêt de travail, la fermeture des ateliers où nous travaillons à deux cents de l’heure (quelques-uns arrivent à quatre cents au bout de six mois). Les entreprises de l’extérieur qui empochent les bénéfices n’aiment pas beaucoup les grèves : ce qui veut dire que le capitaine ne les aime pas non plus parce qu’il subit à cause d’elles des pressions politiques -c’est le système de la « libre entreprise » !
Janvier à San Quentin, est ce qu’il y a de pire, il y fait froid si vous n’avez pas les vêtements appropriés ; c’est humide, sinistre. Les ternes murs verdâtres à arcs-boutants qui entourent la cour supérieure ont dix-huit à vingt mètres de haut. Il vous semble que vous êtes là pour toujours. Le jour dont je parle, mon père était venu de Los Angeles tout seul en voiture ; il n’avait pas dormi plus de deux heures en deux jours. Nous nous serrons la main et la dialectique commence, je me lance contre le chien capitaliste, il m’écoute.
Qui nous a donné ces cochons de flics ? Qui assassine les Vietnamiens ? Qui engraisse certains pour affamer les autres ? Est-ce qu’on ne construit pas dans la même rue des H.L.M. qui ressemblent à des prisons et des maisons qui ressemblent aux jardins de Babylone ? Ne fabrique-t-on pas une bombe chaque fois que l’on construit un hôpital, n’ouvre-t-on pas un bordel pour une école ? Qui construit des avions pour mieux vendre des pilules tranquillisantes ? Qui, pour une église, élève une prison ? Chaque découverte médicale n’a-t-elle pas pour sous-produits dix nouvelles armes pour la guerre biologique ? N’a-t-on pas porté au pinacle des hommes comme Hunt et Hughes [Haroldson Lafayette Hunt et Howard Hugues, archétypes de milliardaires américains criminels ou décadents] et mis plus bas que terre les gens comme nous ? Il me répond : « Oui, mais qu’est-ce qu’on peut y faire ? Ces salauds sont trop nombreux. »
Ses yeux se voilent et son esprit accomplit un retour en arrière dans le temps et l’espace ; il retrouve la souffrance, le délaissement, les rêves impossibles, les promesses rompues, les ambitions oubliées, les espoirs brisés, le temps où il, était jeune, rôdant dans la campagne de Louisiane à la recherche de quelque chose à manger. Il m’a parlé pendant dix minutes de choses révolues, de gens que je ne connaissais pas : « Il va falloir le rendre (quoi ?) à tante Bell », de lieux où nous n’avions pas été ensemble. Deux fois, il m’a appelé du nom de son frère. J’étais tellement saisi que je ne pouvais que rester assis et cligner les yeux.
L’homme qui me parlait ne prenait rien au sérieux, c’était l’homme équilibré, le nègre réaliste, travailleur, ne se plaignant jamais, le « monsieur » noir bien élevé et suave ! Ils l’ont jeté dans l’abîme de la folie. Sous le vernis « blanc » est enfouie la terrible et vindicative fureur noire. Il y a encore beaucoup de Noirs de sa génération, celle de la Grande Dépression, du temps où un Noir ne pouvait même plus s’en sortir en étant serviteur ; même ça s’était tari. Les Noirs se battaient à mort pour des postes de porteur, de groom, de pêcheur de perles, de cireur de chaussures.
Mon poing serré se lève pour eux. Je leur pardonne, je comprends, et s’ils consentent à cesser de collaborer, à cesser « maintenant », et à se rallier à notre révolution, ne serait-ce qu’en acquiesçant d’un signe de tête, nous leur pardonnerons de nous avoir jetés nus dans ce monde grotesque et pernicieux. Les colonies noires d’Amérika ne sont pas sorties de la Dépression depuis la fin de la guerre de Sécession. Nous vivons dans une « dépression régionale » depuis la fin de l’esclavage. Le commencement du nouvel esclavage a été marqué par un chômage massif et un sous-emploi qui est encore notre lot.
La guerre de Sécession a détruit l’aristocratie terrienne. La dictature de la classe agraire a été remplacée par celle du capitalisme industriel. Le néo-esclavagiste a détruit la plantation qui n’était pas rentable, et a construit, sur ses ruines, l’usine où mille subalternes lui sont attachés. Comme nous ne connaissions pas d’autre métier que le travail de la terre, qui s’était révélé un mauvais placement, nous avons reçu en partage les tâches subalternes, les basses besognes.
C’est encore comme ça aujourd’hui : nous formons une sous-culture subalterne, une aire de dépression à l’intérieur du système monstrueux qui nous a créés. Les quatre autres phases du cycle de l’économie capitaliste sont : le rétablissement, l’expansion, l’inflation et la récession. Avons-nous connu un « rétablissement » ou une phase d’expansion ? Nous subissons en victimes les courants inflationnistes de l’économie globale : qui souffre le plus quand le prix des denrées de première nécessité monte ?
Quand l’économie-mère plonge dans l’inflation et la récession, nous connaissons une sous-dépression. Quand elle passe à la dépression, nous sommes réduits au désespoir le plus total. Il n’y a entre l’expérience de mon père et la nôtre qu’une différence de degré. Nous arrivons parfois à trouver quand même un travail, ils ne pouvaient pas ; nous pouvons aller dîner chez maman quand les choses deviennent vraiment serrées ; eux, non. Il y a maintenant la sécurité sociale et un emploi de femme de ménage pour maman. En ce temps-là, la sécurité sociale n’existait pas. La dépression est un phénomène économique.
C’est une phase du cycle économique capitaliste, un de ses aspects nécessaires. Les colonies du capitalisme, marchés secondaires, formeront toujours des aires de dépression : la demande de travail décroît régulièrement, et du fait du progrès de l’automation, devient de plus en plus spécialisée ; ainsi le colonisé, qui n’a pas de spécialisation, en est réduit à des rôles qui lui ferment tout espoir de promotion.
Apprendre les nouvelles techniques (si nous en avions le droit) ne servirait à rien. Cela ne peut aider les masses, parce qu’il y a un plafond pour la demande de main-d’œuvre. Ce plafond baisse à chaque progrès des techniques de production ; apprendre les nouvelles techniques ne ferait que nous mettre en compétition avec les travailleurs en place, une compétition où nous ne pouvons, ni ne voulons gagner. Il n’y a pour nous aucun vide à remplir dans le monde du travail. Et de toute façon, nous ne voulons pas favoriser le capitalisme aux dépens du peuple.
Le capitalisme est l’ennemi, il doit être détruit. Il n’y a pas d’autre solution. Le système n’est pas compatible avec l’élaboration d’une société moderne industrielle et urbaine. Les hommes naissent dans la servitude ; le contrat entre gouvernement et gouvernés perpétue cette servitude. Les hommes en place doivent à ceux qui leur ont fait confiance, une distribution équitable de la richesse et des droits. Chaque individu né dans les cités d’Amérika devrait avoir droit aux biens nécessaires à sa survie. Un rôle social, une éducation, des soins médicaux, la nourriture, l’abri, la compréhension, toutes ces choses devraient lui être garanties dès sa naissance ; en vérité, elles ont été assurées par toutes les sociétés humaines, jusqu’à celles-ci. Pourquoi les hommes laissent-ils d’autres hommes les gouverner ? A quoi servent les ministères de la Santé, de l’Éducation, des Affaires sociales ?
Pourquoi donner à des hommes le pouvoir ? Pourquoi payer des impôts ? Pour rien ? Pour qu’ils disent ensuite que le monde ne doit rien à nos fils ? Ce monde nous doit les moyens de vivre, dès le jour de notre naissance. Ou alors ce n’est pas la peine de parler de civilisation, et nous pouvons dénier le pouvoir à tout dirigeant.
L’évolution de la société urbaine moderne nous a rendus totalement dépendants du gouvernement. Nous ne pouvons plus assurer individuellement la subsistance de notre famille. Nous ne pouvons élever et éduquer nos enfants à la maison, organiser seuls notre propre travail à l’intérieur de la structure urbaine. En conséquence, nous laissons certains se spécialiser dans la coordination de ces activités. Nous les payons, les honorons et leur accordons un pouvoir de contrôle sur certains aspects de nos vies, pour qu’en retour, ils prennent en charge chaque nouveau venu dans cette société et l’aident jusqu’à ce qu’il soit capable de subvenir à ses propres besoins et d’apporter sa contribution à l’œuvre collective.
Si l’homme qui naît dans la société américaine n’a aucun droit, si la profession de foi capitaliste est que « le monde ne vous doit pas les moyens de vivre », alors ce qu’a fait ma grand-mère n’a rien de scandaleux. S’il est vrai que le gouvernement n’a pas pour tâche d’organiser, alors le fait que mon père n’a eu nulle part où chercher de l’aide jusqu’à ce qu’il puisse s’aider lui-même est sans signification.
Mais cela veut aussi dire que nous sommes en proie à une monstrueuse contradiction et ne pouvons pas plus prétendre être civilisés qu’une bande de babouins. Qu’est-ce alors qui a mis obstacle au bien-être de mon père ? Qui a condamné toute sa génération à une vie sans joie ? Qui a opprimé ceux de mon âge depuis leur naissance et pendant chaque jour de leur vie ?
C’est le capitalisme, l’homme du capitalisme, briseur de mondes, fléau du peuple. Il ne peut satisfaire nos besoins, il ne peut ni ne veut se transformer et s’adapter aux changements naturels qui se produisent à l’intérieur d’une société. C’est l’homme noir qui a subi les préjudices les plus graves. Il ne servirait à rien de s’attarder sur ces drames, ils sont innombrables, nous n’y pouvons plus rien. Mais nous, qui avons survécu, devons enfin faire un retour sur nous-mêmes et nous interroger. Le système social est basé sur la compétition : compétition pour la richesse, les honneurs et les titres ; le Noir dressé contre lui-même, dressé contre les classes pauvres des Blancs et des Bruns, la compétition sans merci, sournoise, virulente, le style de vie amérikain.
Cette compétition a tué la confiance. Pour les Noirs, une prime est offerte à la méfiance. Tout autre Noir est vu comme un rival ; l’homme astucieux et réaliste est celui qui se fiche pas mal des autres cons, le cynique qui a laissé tomber tout principe qu’il aurait pu ramasser par erreur. Nous ne pouvons aimer si nous supposons que l’autre va inévitablement se servir de notre amour comme d’une arme contre nous. Il va falloir repartir à zéro, et cette fois, tout sera au grand jour, nous ne nous trahirons plus les uns les autres, nous connaîtrons la confiance et l’amour.
J’exclus quiconque est partisan, si peu que ce soit, du capitalisme, ou a le sentiment d’avoir quelque chose à perdre à sa destruction. Celui-là est notre ennemi irréconciliable. Nous ne pouvons plus compter sur des gens comme Cosby, Gloves Davis [l’agent de police noir de Chicago qui tua Fred Hampton] ou le vieux conducteur d’autobus qui a témoigné au procès de Huey Newton. Tout homme qui se lève pour défendre le capitalisme doit être jeté à terre.
C’est maintenant, « aujourd’hui », que notre maladie doit être identifiée comme étant le capitalisme, machinerie monstrueuse qui possède, programmé dans chacun de ses cycles, le pouvoir insensé de nous meurtrir.
Je suis né avec un cancer incurable, un mal pernicieux et suppurant qui m’a attaqué juste derrière les yeux et n’a cessé de s’étendre pour détruire ma paix. Il m’a volé ces vingt-huit années. Il nous a volé à tous bientôt cinq siècles. Le plus grand criminel de tous les temps. Nous allons l’arrêter maintenant.
Rappelez-vous les histoires que vous avez lues sur les animaux qui vivent en troupeaux : le grand bison, le caribou, renne américain. Le grand bison américain est un animal grégaire ou, si vous préférez, social, tout comme nous. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin, pour nous sentir en sécurité, d’avoir autour de nous d’autres individus de notre espèce. Rares sont les hommes qui aiment la solitude complète ; être constamment seul est une torture pour l’homme normal. Le bison, le bœuf, le caribou et quelques autres ressemblent aux hommes en ce qu’ils ont besoin, la plupart du temps, de compagnie ; ils ont besoin de se frotter les uns aux autres tout comme nous nous serrons la main, nous tapons dans le dos ou nous embrassons.
De tous les habitants de la planète, nous autres Noirs sommes ceux qui aimons le plus être ensemble, nous sommes les plus sociables. Les animaux grégaires mangent, dorment et se déplacent en groupe. Ils ont besoin d’être avec les autres pour se sentir en sécurité. Ce qui signifie aussi qu’ils ont besoin de chefs. Si le bison doit manger, dormir et se déplacer en groupe, cela implique logiquement un facteur de coordination, autrement certains dormiraient pendant que les autres voyageraient. Sans ce rapport du troupeau à son chef, le groupe se disperserait, aux moments critiques, en cent directions différentes. Mais si le chef du troupeau fait un faux pas, glisse et se tue en tombant d’une hauteur, il est probable que tout le troupeau périra à sa suite. Le chasseur l’a bien compris. Le prédateur a appris, en constatant ce phénomène, que chaque groupe se donne naturellement un chef, et qu’à ces chefs naturels revient la responsabilité de la coordination des activités du groupe, de son organisation.
Le chasseur de bisons savait que, s’il pouvait identifier et isoler le chef du troupeau et le tuer, le reste des animaux serait sans défense, à sa merci. Nous autres Noirs avons le même problème que le bison, la même faiblesse aussi, et le prédateur comprend très bien cette faiblesse.
Huey Newton, Ahmed Evans, Bobby Seale, des centaines d’autres devront périr conformément au plan fasciste. C’est une sorte de sélection naturelle à l’envers. Medgar Evers, Malcom X, Bobby Hutton, Brother Booker, W. L. Noland, M. L. King, Featherstone, Mark Clark et Fred Hampton ne sont qu’un petit nombre de ceux qui ont connu le sort du bison. L’effet sur nous de ces agissements de la droite est classique et semble sortir d’un manuel scolaire d’économie politique fasciste.
A l’instant où émerge une tête noire, on la coupe ou on la pend avec l’accord des tribunaux et de la presse ; la réponse prédéterminée à cette situation est une indifférence schizoïde, la fuite ou le refuge en des satisfactions imaginaires. « Oh jours heureux, oh jours heureux, oh jours heureux. » L’auto-hypnose conduit à l’hallucination. Le chef noir possible voit la condition lamentable du troupeau : la corruption, les préoccupations futiles, l’évidente inaptitude à s’occuper des questions vitales. Il pèse ce qu’il peut attendre de cette masse et les risques qu’il encourrait entre les mains du monstre fasciste et, naturellement, il décide de se débrouiller tout seul ; il sent qu’il ne peut pas nous aider parce que notre cas est désespéré, et se dit qu’il ferait mieux de profiter de la vie.
Tels sont les Noirs qui ont « réussi » par opposition aux « ratés ». On les trouve sur les terrains de sport, sur la scène, jouant la comédie et s’amusant à des jeux d’enfants ; ils sont tout aussi pitoyables que les prétendus ratés.
Nous avons été colonisés par l’économie blanche fasciste et c’est d’elle que nous tenons notre semblant de sous-culture, et les attitudes qui perpétuent notre condition, ces attitudes qui nous font nous livrer les uns les autres aux flics du Klan. Il nous arrive même de travailler à leurs côtés, pistolet en main. C’est un Noir qui a tué Fred Hampton ; ce sont des Noirs travaillant pour la C.I.A. qui ont tué Malcom X ; les nombreuses polices par lesquelles le fascisme se protège du peuple, emploient beaucoup de Noirs.
Ces attitudes fascistes nous ont envoyés en Europe, en Asie (un quart des morts du Vietnam sont noirs), et même en Afrique (au Congo, pendant la tentative de Simba d’établir un gouvernement populaire) mourir pour rien. Dans les événements récents d’Afrique et d’Asie, nous avons laissé le néo-esclavagiste se servir de nous pour asservir des peuples que nous aimons. Nous sommes si perdus, si invraisemblablement naïfs que, non seulement nous n’arrivons pas à distinguer en général le bien du mal, mais encore nous ne voyons pas ce qui est bon ou mauvais pour nous dans des questions qui nous concernent directement, comme la libération des colonies noires.
L’entreprise économique du gouvernement dont le seul but est de nous asservir un peu plus, de nous tenir et de nous espionner, l’entreprise noire payée par l’État pour s’infiltrer parmi nous et retarder notre libération, sont acceptées et même parfois bien accueillies. Mais on évite les Panthères noires, ils ont du mal à trouver protection parmi le peuple. Ils sont nos frères, nos fils, ceux qui n’ont pas peur, ceux qui n’ont pas été aussi paresseux que les autres ; ceux dont la vision n’a été ni rétrécie, ni obscurcie. Si nous laissons la machine fasciste détruire ces frères, notre rêve d’éventuelle autodétermination et de contrôle de notre existence, mourra avec eux, et les générations à venir nous maudirons et nous condamnerons pour cette lâcheté irresponsable.
J’ai un frère courageux, je l’aime plus que moi-même, mais je l’ai donné à la révolution. J’accepte la possibilité de sa mort, comme j’accepte l’éventualité de la mienne. Une faiblesse, un faux pas, une erreur, et nous sommes morts ; nous sommes ceux qui ne peuvent se permettre aucune faute. J’accepte cela comme un aspect nécessaire de notre vie. Je ne veux plus voir d’esclaves noirs. J’ai un ennemi bien précis qui ne nous accepte que sur la base maître-esclave. Si je me révolte, l’esclavage meurt avec moi. Je refuse de le perpétuer. Voilà le sens de ma vie.
Maman noire, il va falloir que tu cesses de fabriquer des lâches : « sois bien gentil », « je vais être si inquiète, mon petit », « ne te fie pas à ces nègres », « ne te laisse pas faire par ces mauvais nègres, mon petit », « gagne bien de l’argent, mon petit ». Maman noire, ton souci exagéré de la survie de tes fils se paie de la perte de leur humanité.
Le jeune membre du parti des Panthères, notre éclaireur, il faut l’accepter, le protéger, le laisser faire. Nous devons l’écouter et l’instruire ; il sera bientôt un homme, un fils, un frère dont nous pourrons être fier. S’il flanche, nous le remonterons ; chaque fois qu’il fera un pas, nous le ferons avec lui. Nous aurons la même dialectique, nous communierons dans une parfaite harmonie. Jamais plus, jamais, il n’y aura une autre affaire Fred Hampton.
Le Pouvoir au peuple.