[Ce numéro est illustré par les gravures de l’Internationale de F. Masereel]
Le 15 mars, une association de patrons d’agences de voyages a fait remarquer, suite à la grève des pompiers de l’aéroport de Zaventem, que si un tel mouvement avait eu lieu aux Etats-Unis, les grévistes auraient tous été licenciés, que s’il avait eu lieu en Russie, ils auraient tous été envoyés au goulag, et que s’ils l’avaient fait en Chine, ils auraient tous été fusillés.
On imagine bien la colère que cette grève a inspiré à ces patrons mais en vérité, leur propos n’est pas tout à fait clair. Que souhaitent-ils au juste les patrons des agences de voyages ? Que tous les pompiers de Zaventem soient licenciés ? Qu’ils soient emprisonnés ? Ou qu’ils soient fusillés ? Un prochain communiqué nous éclairera peut-être.
En attendant, remarquons que dès l’annonce de cette grève, la direction et les autorités ont eu un cri du cœur bien connu : ils ont dénoncé la » prise en otage » des passagers. Etrangement lorsque 1400 travailleurs d’Opel-Anvers ont appris que le patronat de General Motors envisageait leur licenciement, il ne s’est trouvé personne pour les traiter d’otage des capitalistes…
Lorsque la fille chérie d’une oligarchie qui règne sans partage sur la Colombie depuis des décennies, Ingrid Betancourt, petite-fille par alliance du président Betancourt, et elle-même candidate à la présidence est capturée par la guérilla, toutes les trompettes de l’Occident (du service de l’information du département d’Etat US au chanteur Renaud en passant par le bourgmestre de Bruxelles) font chorus : il faut libérer cette « otage ».
Mais qui parle de libérer le peuple de Colombie, otage depuis des décennies de l’oligarchie à laquelle appartient Bettancourt ? Qui parle de libérer les centaines et les milliers de sympathisants de la guérilla ou de syndicalistes enfermés à Bogota et dans tout le pays ? Entend-on parler d' »otages » à propos de ces prisonniers échappés souvent par miracle aux escadrons de la mort de l’oligarchie ?
Lorsqu’à la suite d’une querelle inter-impérialiste (l’Empire châtiant en Saddam un vassal indiscipliné), le peuple irakien a été livré aux multinationales US par la soldatesque états-unienne, personne n’a parlé de gigantesque « prise d’otages » (pourtant, un peuple entier ! excusez du peu). Mais lorsque quelque agent de cette occupation, un mercenaire du pillage pétrolier (pardon : un « expert en reconstruction »), un mercenaire du maintien de l’ordre (pardon : un « security contractor »), ou un mercenaire de la propagande (pardon : un « journaliste ») est capturé par les fractions en rébellion de ce peuple humilié et opprimé, les bonnes consciences occidentales se réveillent : pourvu qu’il n’arrive rien à cet « otage ».
Le mot « otage » sert à disputer à son ennemi le droit d’intervenir sur la vie d’autrui : l’Empire a des « prisonniers » (détenus à Guantanamo et ailleurs, au mépris du droit national et international), les rebelles ont des « otages ». L’usage de ce vocable a connu une inflation aussi fascinante que celui de terroriste. On sait que la définition du mot « terroriste » a donné lieu à de nombreux débats. Il existe pourtant des définitions raisonnables. Nous pouvons même contribuer au débat en proposant une définition de notre cru : «Est terroriste celui qui jette délibérément des bombes sur des civils désarmés (même s’il pilote un avion de l’US Air Force)» . Mais les journalistes du régime en usent autrement. En gros : l’Empire a des « soldats », les rébellions ont des « terroristes ».
Et comme l’indigence du vocabulaire couronne l’indigence de la pensée, le mot « otage », comme le mot « terroriste », est employé jusqu’au ridicule (ainsi les businessmen obligés à Zaventem de reporter d’un jour leur voyage « pris en otage »).
Alors quoi? Tous otages? Tous terroristes? Au vrai, le mot « chien » ne mord pas et, dès le moment où les grosses ficelles des pisses-copies du régime sont mises à nu et que par dessus le marché, elles apparaissent usées jusqu’au dernier brin, le question ne mérite pas une ligne de plus.
1. Histoire et état du secteur
Entre 1945-1975, l’industrie automobile européenne a pris pour modèle les Etats-Unis. Elle a mis en œuvre le taylorisme : production de masse dans de gigantesques usines ; cadences infernales compensées parfois par certains avantages salariaux et sociaux (congés, etc.) ; recours massif à l’immigration pour un travail à la chaîne qui suscite de fortes résistances ouvrières, etc.
A partir des années 1975-1980, un nouveau modèle de production se met en place, inspiré des usines Toyota, fondé sur la flexibilité, le zéro stock, etc. L’imposition de ce nouveau modèle a coïncidé avec le tournant bourgeois vers le néolibéralisme. Celui-ci, induisant un désengagement de l’Etat de l’économie, suppose non seulement la privatisation de secteurs de plus en plus larges, mais aussi la fin des politiques douanières et tarifaires qui protégeaient les industries nationales de la concurrence étrangère.
La « mondialisation » libérale s’est traduite dans le secteur automobile par une âpre concurrence pour la conquête de parts de marché: les groupes se sont développés à l’international, ils ont multiplié les alliances, fusions, absorptions ou ententes, et ont tous tenté des pénétrations croisées sur les marchés traditionnels de leurs concurrents.
A partir des années 1990, tous les constructeurs se sont recentré sur leurs « métiers de base » : conception des véhicules, fabrication de certaines pièces maîtresses, montage final et commercialisation. Ils délocalisent une partie de cette production en fonction des marchés à conquérir et des coûts salariaux. Ils mettent en place des plates-formes qui fabriquent les châssis communs à plusieurs modèles et se contentent d’assembler des blocs fabriqués par des équipementiers, en faisant massivement appel à la robotique.
Une sous-traitance en cascade se met en place, avec des fournisseurs de premier rang, qui traitant eux même avec des sous-traitants de deuxième rang et ainsi de suite. Cette tendance induit une chute particulièrement forte du taux de profit: les profits restent élevés, et ils sont souvent même en hausse, mais il est besoin d’une masse toujours plus importante de capitaux pour les générer.
L’automobile est un secteur industriel très concentré. Il y avait 2.000 constructeurs en France au début du XXe siècle, 155 en 1914, deux aujourd’hui. Une petite dizaine de monopoles se partagent le marché mondial, dont les principaux sont General Motors (8.25.000 véhicules fabriqués, 341.000 salariés, 195 milliards d’euros de chiffre d’affaire), Ford (6.730.000 véhicules, 350.000 salariés, 170 millliards d’euros), Toyota-Daihatsu (6.626.000 véhicules, 264.000 salariés, 129 milliards d’euros), VW-Audi (5.020.000 véhicules, 325.000 salariés, 87 milliards d’euros), Daimler-Chrysler (4.456.000 véhicules, 365.000 salariés, 149 milliards d’euros), Peugeot-Citroën (3.262.000 véhicules, 198.000 salariés, 54 milliards d’euros), Fiat (2.190.000 véhicules, 190.000 salariés, 50 milliards d’euros), Renault (2.328.000 véhicules, 132.000 salariés, 36 milliard d’euros), Honda (2.989.000 véhicules, 127.000 salariés, 64 milliard d’euros) et Nissan (2.719.000 véhicules, 127.000 salariés, 54 milliards d’euros).
A ces monopoles s’ajoutent des groupes moins importants (comme BMW-Rover), des groupes en pleine croissance (comme Hyundai). En Chine et en Inde, d’importantes industries jusqu’ici tournée vers le marché intérieur commencent à se redéployer en vue d’une conquête du marché mondial (le groupe Jiangsing Motor, qui produit actuellement 28.000 voitures par an, dit vouloir tripler sa production en cinq ans).
Des alliances se font et de défont. Renault a par exemple scellé en 1999 une alliance avec Nissan dont il possède 44% du capital, et a cédé à Volvo sa filiale de véhicules industriels en échange d’une participation de 20% dans le capital du groupe suédois. Renault a également acquis la division automobile de Samsung en Corée et de Dacia en Roumanie.
2. Un secteur en crise, un secteur en lutte
La crise est réelle mais elle n’est pas la même pour tous. Toyota a engrangé un profit de 5,18 milliards d’euros, (en hausse de 15,3%), tandis que General Motors essuyait 10,6 milliards de dollars de perte. La plupart des groupes continuent de gagner de l’argent. C’est le cas des groupes européens, mais les marges qu’ils dégagent sont plus faibles que celles des groupes asiatiques, et la tendance est plutôt à la baisse des ventes et de la rentabilité.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de la crise.
La baisse tendancielle du taux de profit est inévitable dans un secteur de plus en plus automatisé, où la part du capital fixe (investissements techniques) l’emporte de plus en plus largement sur la part du capital variable (main-d’œuvre), source de la plus-value.
A cela s’ajoute la hausse du prix des matières premières, et singulièrement la hausse du pétrole (qui affecte tant la production que l’achat des voitures).
En Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, la diminution du pouvoir d’achat des masses, et l’incertitude quant à leur avenir qui les incite à épargner plutôt que consommer, se conjugue à la la saturation du marché (en Europe, 26,5 millions de voitures peuvent être produites, mais il y a seulement 20,5 millions vendues), et aux aspirations écologiques d’une part non négligeable des consommateurs solvables.
Certains constructeurs ont pu tirer leur épingle de ce jeu en faisant preuve d’une meilleure adaptation au marché. Alors que les constructeurs américains subissent des pertes en produisant des voitures consommant beaucoup, Toyota a développé la voiture hybride qui remporte un franc succès (312.000 véhicules construits en 2006, soit plus 33%), à tel point que le groupe ouvrira en 2009 aux USA une usine qui produira 200.000 voitures hybrides par an. D’autres constructeurs font des profits en se cantonnant dans des segments particuliers du marché, comme BMW-Rover dans le haut de gamme.
A l’époque de l’impérialisme, la structure et le comportement de l’actionnariat des groupes financiers se déconnecte de plus en plus de la production pour adopter une position purement prédatrice. Il ne s’agit plus de quelques « grandes familles » qui pouvaient encore avoir une approche patrimoniale de leurs investissements (liées à une entreprise particulière depuis plusieurs générations et, croyaient-ils, pour plusieurs générations, elles avaient le souci de ce qui pouvait arriver à long terme à cette entreprise).
La rapidité avec laquelle les investisseurs déplacent des masses énormes de capital d’un secteur à l’autre, d’une entreprise à l’autre, est sans commune mesure avec ce que l’on connaissait avant les dérégulations néolibérales.
En raison de cette accélération des échanges financiers et de la volatilité du capital, les seuls critères sont les profits rapides et la rétribution des actionnaires, les managers industriels sont contraints par les managers financiers (qui gèrent les fonds d’investissement et qui sont eux-mêmes en concurrence pour la meilleure rentabilité) de maximaliser les profits et de jeter des dividendes de plus en plus gros aux actionnaires.
C’est ainsi que le plan de restructuration de VW, qui a débouché sur les accords de surexploitation des ouvriers allemands et sur les pertes d’emplois massives à VW-Forest, est survenu alors que VW avait réalisé en 2005 un bénéfice double du bénéfice record de 2004, (1,25 milliards d’euros), et que le bénéfice prévu pour 2006 était de 5,1 milliard d’euros !
Pour augmenter les profits, tous les groupes automobiles restructurent. C’est ainsi que General Motors a initié, en octobre 2005, un plan de redressement qui doit aboutir à la fermeture d’une douzaine d’usines en trois ans et à la suppression de 34.000 emplois. C’est dans ce cadre que l’usine Opel d’Anvers pourrait perdre 1.400 emplois faute de produire la nouvelle Astra. Aux USA, un accord signé avec le syndicat UAW fera également faire à General Motors trois milliards de dollars d’économie par an sur les dépenses de santé du personnel actif et retraité. Chez VW, le plan qui a touché l’usine de Forest envisage 20.000 suppressions d’emploi en trois ans, auxquelles s’ajoute le retour de 28,8 à 35 heures hebdomadaires (sans augmentation de salaire) pour les 160.000 salariés allemands du groupe. De son côté, Peugeot-Citroën supprimera 10.000 emplois.
Outre les suppression d’emploi pures et simples, il y a une dégradation générale des conditions d’embauche. Le recours à des intérimaires se généralise, et un ouvrier de l’automobile peut ainsi rester des années entières dans un usine sans être sous contrat avec le constructeur. En Europe occidentale, 20% des travailleurs du secteurs sont en statut précaire.
Aux restructurations s’ajoutent les délocalisations.Le groupe Peugeot-Citroën produit des véhicules au Brésil (à Porto Real), en Argentine (à Buenos Aires) et en Chine (à Wuhan). Sa production européenne se fait de plus en plus en Europe de l’Est, dans les usines de Tchéquie (à Kolin) et Slovénie (à Trnava), et ses équipementiers traditionnels suivent le mouvement (ainsi la société Faurecia qui vient de délocaliser 1.200 emplois de France en Tchéquie).
En Belgique, où sont installés cinq grands constructeurs, entre les restructurations et les délocalisations, le secteur automobile a perdu 16.000 emplois (postes de travail supprimés ou transformés en emplois précaires), soit la moitié des emplois qu’il comptait en 1990.
De pareilles conditions ne peuvent qu’engendrer des luttes. Au moment où nous écrivons ces lignes (avril), les ouvriers de l’usine Peugeot-Citroën d’Aulnay étaient à leur septième semaine de grève pour les salaires, la retraite à 55 ans et l’embauche des intérimaires. Cette grève a bénéficié de l’appui des luttes de la sous-traitance : les travailleurs de LEAR (fabricant des sièges), Lajous (fabricant de rampe d’injection), Sévelnord et Faurécia ont également fait grève pour les salaires.
En janvier, 90% des ouvriers de l’usine General Motors de Strasbourg étaient en grève. Ils demandaient 100 euros d’augmentation à une direction qui voulait imposer davantage de flexibilité. En sept ans, le nombre d’ouvriers est tombé dans cette usine de 2100 à 1500 pour le même nombre de véhicules produits. Après une semaine de grève (et deux jours de blocage de la production), une augmentation de 75 euros a été arrachée, et le plan de flexibilité a été mis de côté.
Derrière ces grèves « classiques », il faut remarquer l’émergence des luttes revendicatrices dans les chaînes de production délocalisées. Les ouvriers de Ford en Russie (à Petersbourg), de General Motors en Pologne, de Renault en Roumanie (dans l’usine Dacia qui fabrique la Logan) et de VW en Tchéquie (usine Skoda) se sont mis en grève par milliers, et ont arrachés d’importantes augmentations de salaires (17% chez Skoda !).

Debout ! les damnés de la terre !
Debout ! les damnés de la terre !
Debout ! les forçats de la faim !
La raison tonne en son cratère,
C’est l’éruption de la fin.
Du passé, faisons table rase,
Foule esclave, debout ! debout !
Le monde va changer de base !
Nous ne sommes rien, soyons tout !
3. La grève à VW-Forest : « Un meeting de sept semaines »
C’est ainsi qu’un camarade a désigné la non-lutte à VW. Les ouvriers de l’usine de Forest avaient pourtant la réputation d’être actif sur le front de la lutte des classes. Ils ont mené de nombreux combats contre les projets patronaux dans l’usine, et ils ont toujours été présents dans les conflits qui impliquaient la classe toute entière (soit en solidarité avec d’autres luttes, comme celle de Clabecq, soit contre des projets gouvernementaux, comme le « Pacte des générations »).
Un survol historique des luttes à VW-Forest depuis 1990 témoigne de cette combativité : avril 1990 : conflit sur la sous-traitance ; février 1991 : grève pour les 32 heures ; avril 1992 : protestation contre des licenciements ; avril 1993 : grève contre 500 licenciements ; juillet 1993 : protestation contre des mutations et la diminution des pause ; février 1994 : protestation après le licenciement de deux ouvriers ; juillet 1994 : action contre le plan de restructuration ; septembre 1994 : grève contre les cadences infernales ; avril 1995 : action contre les limitations du droit de grève ; juillet 1995 : trois grèves pour exiger le départ du chef du personnel ; décembre 1995 : grève contre l’interdiction de manifestation ; février 1996 : plusieurs grèves et actions spontanées ; mars 1997 : protestation contre le retard de la convention collective ; septembre 1998 : grève spontanée après des licenciements ; octobre 1999 : protestation contre le risque de disparition de la production de SEAT ; décembre 1999 : action contre la limitation de la production ; mars 2000 : protestation contre des restructurations ; juin 2001 : action de sabotage contre des licenciements ; novembre 2003 : grève spontanée contre les cadences infernales ; novembre 2005 : l’usine est complètement à l’arrêt pendant la lutte contre le « Pacte des générations ».
Et puis donc, ces sept semaines de lutte contre la restructuration en novembre-décembre 2006.
Pourquoi parler de non-lutte? Parce que cette grève rampante, sans occupation ni assemblée, sans véritable discussion ou perspective, a été cantonnée dans le cadre le plus étroit possible. Rien n’a été fait pour l’étendre, et la manifestation de solidarité du 2 décembre a été un cortège d’enterrement plutôt qu’une démonstration de forces.
A l’arrivée, 1.900 ouvriers ont accepté un départ « volontaire » (en une échange de primes astronomiques pour les 1.500 premiers d’entre eux), et les conditions acceptées par les restant sont incroyablement dures: nouvelles augmentations de productivité (en plus des 33% réalisés entre 2001 et 2005!), flexibilité accrue, alignement d’ici 2009 des conditions d’exploitation sur l’usine est-allemande VW-Mosel, où le coût salarial est de 16,9 euros l’heure pour 23,8 euros l’heure aujourd’hui à Forest, etc.
L’application de ces nouvelles conditions a d’ailleurs engendré plusieurs nouvelles grèves sauvages. Des rumeurs persistantes à l’intérieur de la FGTB font état d’intrigues de la direction syndicale pour obtenir le licenciement de ceux de ses propres militants qu’elle juge trop combatifs et « perturbateurs », pour qu’enfin la paix sociale revienne dans l’usine.
Car dès le début, les syndicats ont optés pour la « non-lutte ». A l’annonce des milliers de pertes d’emploi, le délégué principal ABVV Metaal (la Centrale flamande FGTB des métallurgistes), Jan Van Der Poorten a résumé la position du syndicat : «Il nous faut de l’argent». Donc, dès la première heure, il était hors de question de lutter contre les licenciements. Les appels au calme et à la responsabilité ont vite tourné au programme de démobilisation. Ainsi les délégués se sont bornés à dire aux travailleurs réunis en assemblée dans l’usine que les négociations commençaient et qu’ils devaient rentrer chez eux, écouter la radio, regarder la télé et lire les journaux pour suivre l’évolution des pourparlers…
Le sabotage syndical de la manifestation de solidarité du 2 décembre a été évident: il n’y a pas eu de vrai appel à y participer dans les entreprises (pas même dans les entreprises du secteur).
Pourtant, à l’annonce de la grève, de nombreuses forces solidaires s’étaient mobilisées.
Dans plusieurs usines, où l’on n’avait pas oubliés les mobilisations solidaires de la part des ouvriers de VW, une action de soutien était possible. Instruites par Clabecq, de nombreuses forces politiques étaient elles aussi prêtes à appuyer l’extension et l’approfondissement de la lutte, avec leurs propres moyens et méthodes, y compris des forces que l’on n’a pas l’habitude de voir sur le terrain de la lutte des classes (ainsi les anarchistes qui, en solidarité avec la lutte de VW, ont incendié, le 30 novembre, les bancontacts de Drogenbos et de Ruisbroek).
Dans l’usine même, pendant toute la durée de cette lutte, il y avait des centaines de travailleurs de VW prêt à mener la lutte et à étendre le mouvement ne fut-ce qu’en informant d’autre usines. Les propositions offensives des travailleurs de VW (comme le blocage des lignes SNCB passant derrière l’usine) ont systématiquement été rejetée par les délégués.
Le syndicat veilla à contenir la mobilisation dans les limites de l’usine, en négligeant honteusement le cas des sous-traitants. Nous parlons ici de plus plusieurs dizaines d’entreprise regroupant des milliers de travailleurs : le tout dans le tout, l’emploi de 12.000 personnes dépendaient de VW-Forest. La situation de ces travailleurs est, en général, détestable : contrat précaire, intérim prolongé, travail dur et salaire médiocre (chez Johnson Controls, où l’on fabrique les siège de Golf, les salaires, toutes primes comprises, ne dépassent pas 1200 euros par mois). Les ouvriers de ces boites ont pourtant mené une lutte exemplaire, certains allant jusqu’à occuper leur entreprise, et cela contre l’avis les directions syndicales.
Tout le monde a pu constater la surreprésentation des 1900 prépensionnés et « prépensionnables » parmi les travailleurs combatifs (ainsi ceux présents au piquet). Ceux-ci étaient dans une situation particulière: quelques années d’activité supplémentaire à VW-Forest les auraient mis à l’abri des attaques du « Pacte des génération ». Or, l’accord syndicat-direction rend obligatoire la prépension pour tous les travailleurs de plus de 50 ans. Obligés de quitter VW, ils seront peut-être prochainement contraints, par le « Pacte des générations » et ses prévisibles successeurs, de se faire employer ailleurs, dans les conditions que l’on devine.
Comment expliquer cette apparente contradiction entre la tradition combative de VW et cette non-lutte de novembre-décembre ?
La difficulté qu’ont les syndicalistes de lutte de classe de s’affranchir du cadre syndical, de critiquer et de dépasser la hiérarchie syndicale lorsque besoin est, a eu ici des effets désastreux.
On sait que la délégation FGTB des Forges de Clabecq, qui avait dirigé pendant des années une dure lutte pendant laquelle elle avait combattu la logique capitaliste et dénoncé la logique du syndicalisme « de gestion », fut exclue de la FGTB. La délégation syndicale de VW (et les travailleurs de l’usine) avait fait montre d’une grande solidarité avec la grève de Clabecq. Or, par la suite, les délégués FGTB de VW-Forest ont voté à l’unanimité l’exclusion de la délégation syndicale des Forges de Clabecq, suivant en cela la consigne d’une hiérarchie syndicale particulièrement corrompue. Rappeler cet épisode est utile pour montrer à quel point la délégation de VW se voulait une courroie de transmission de la direction de la FGTB.
Même l’assez forte minorité des travailleurs opposés à l’arrêt de la grève (25% des salariés, soit 21% des employés et 44% des ouvriers) n’ont pas su rompre avec le carcan syndical. C’est le cas du groupe d’ouvriers qui entouraient Daniel Malerba et qui voulaient continuer la lutte après le second referendum. Non seulement ils n’ont pas su rompre avec cet appareil, mais par dessus le marché, ils ont été instrumentalisés par Manu Castro et Nico Cué de la régionale liégeoise de la FGTB, dans le cadre d’un règlement de compte à l’intérieur de l’appareil.
Autre facteur d’affaiblissement de la position des ouvriers de VW-Forest : la communautarisation de la crise. Dès le début du conflit, la presse bourgeoise a joué cette carte à fonds. Nous avons ainsi pu lire dans les journaux flamands que «quelques ivrognes borains» , des «durs des durs» , poussaient seuls à la grève et prenaient «tout le personnel de VW en otage» . (oui oui… « en otage » …). Les referendum ont montré que 44% des ouvriers voulaient continuer la lutte : tous des « ivrognes borains » ?
Le plus grave, c’est qu’à la fin du conflit de VW, ce discours commençait à prendre chez plusieurs des travailleurs que nous avons pu rencontrer. L’ennemi n’était plus le patronat de VW mais l’ouvrier flamand pour l’ouvrier wallon, et l’ouvrier wallon pour l’ouvrier flamand. Voilà le premier et désastreux résultat de scission, sur une base communautaire, de la Centrale des des métallurgistes, scission exigée par les directions syndicales.
4. Une direction syndicale kollabo
Pour mesurer à quel point la direction syndicale prône la collaboration de classe, il faut écouter Herwig Jorissen, président d’ABVV Metaal (et ancien militant du VMO).
En avril, 500 travailleurs de SML, un sous-traitant de Ford-Genk qui assemble les moteurs et productions des essieux, se sont mis en grève. Ils revendiquaient une augmentation d’un euro par heure et des embauches pour faire face aux cadences infernales. Les syndicats ont négocié une augmentation de soixante centimes l’heure et huit embauches. Insuffisant pour les travailleurs qui ont réussi à paralyser pendant quatre jours la production totale chez Ford-Genk.
Les travailleurs de SML ont été rejoints dans la lutte par ceux de LEAR (fabricant de sièges), IAC (fabricant de tableaux de bord) et TDS (fabricant de pièces détachées). Les produits de ces quatre usines sont acheminés directement, par tapis roulant, à la chaîne de montage de la Ford Mondeo.
Les syndicats qui, comme d’habitude sont plein de compréhension pour la « situation difficile » de l’usine, ont décidé de ne pas reconnaître la grève.
Jorissen a alors fait plusieurs déclarations à la presse. Il a ainsi déclaré: «C’est complètement insensé! Est-ce que ces grévistes comprennent seulement à quel point leur action est irresponsable ? Le préjudice qu’ils causent à Ford est hors de toute proportion» , et plus fort encore: «Les grévistes jouent un jeu dangereux, leur action peu conduire à la catastrophe. Non seulement il y a la perte économique pour Ford, mais aussi la perte d’image. On ne va plus regarder Ford Genk comme une entreprise où la production est tout le temps assurée» .
La FGTB comme la CSC ont récemment adhéré à la Confédération Syndicale Internationale (C.S.I.), dont le président a déclaré qu’il fallait «accompagner les délocalisation».
C’est un nouvel ancrage dans un syndicalisme de gestion, à l’image du syndicat allemand IG Metall qui siège dans les conseils d’administration des entreprises (et notamment chez VW), qui co-organisent non seulement les licenciements de dizaines de milliers de travailleurs, mais aussi la mise en concurrence des usines du groupe entre elles. Rappelons qu’IG Metall n’est pas seulement co-gestionnaire de VW à titre de syndicat, elle l’est aussi à titre d’actionnaire !
La compromission des direction syndicales avec la bourgeoisie n’a plus de limite. Jan Van Der Poorten figurera aux prochaines élections sur les liste du Sénat pour le SP.a en Flandre orientale. On avait pu l’entendre dire, lors du referendum sur la reprise du travail le 5 janvier : «Si la réponse est positive, cela voudra dire qu’on a bien travaillé».
Il n’était pas le seul à se réjouir ce jour là, Christian Henneuse (FGTB) déclarait alors : « On ne peut pas parler sereinement de l’avenir de l’usine avec la direction si en même temps on est dans la rue » … Henneuse pense sans doute que l’on peut mieux discuter avec la direction quand ont est, pour moitié, résignés à subir des cadences infernales et, pour l’autre moitié, envoyés au FOREM et à l’ORBEM pour entendre une gamine vous expliquer comment rédiger un CV…

Il n’est pas de sauveurs suprêmes :
Ni Dieu, ni César, ni tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes !
Décrétons le salut commun !
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot,
Soufflons nous-même notre forge,
Battons le fer quand il est chaud !
5. En appeler aux « pouvoirs publics » contre le « néolibéralisme » ?
La dénonciation de la mondialisation néolibérale, des monopoles et des multinationales, etc. qui accompagne souvent le discours des luttes dans le secteur, n’est pas sans ambiguïté. Car elle suppose que les choses pourraient en aller autrement si l’Etat « voulait bien » adopter une autre politique.
A l’occasion de la lutte chez VW-Forest, on a entendu les trotskistes de Lutte Ouvrière revendiquer une loi pour «interdire les licenciements» ; ceux du MAS estimer que «des pouvoirs publics vraiment au service des intérêts des travailleurs prendraient en mains le site de Forest, maintiendraient tous les emplois et y réorienteraient la production sur base d’un débat de société sur la mobilité» ; le POS proposer que «L’usine de Forest pourrait, par exemple, se consacrer à la production des véhicules de transport en commun et du matériel devant équiper le RER bruxellois ou lancer une initiative publique de production d’un véhicule sûr et écologique» , et le PTB demander au gouvernement qu’il exige «le remboursement des avantages fiscaux accordés voire saisir le milliard d’euros de son centre de coordination».
Or, en réalité, l’Etat intervient tant qu’il peut dans le secteur. Tant qu’il peut, c’est-à-dire dans le cadre des règles que la bourgeoisie internationale tente de s’imposer à elle-même à l’intérieur du projet néo-libéral.
L’Etat ne peut plus intervenir d’une manière qui fausserait la concurrence, mais par mille et une astuces, il intervient pour favoriser les constructeurs implantés sur son territoire.
Dans le cas de VW-Forest, l’usine avait obtenu une baisse des charges sociale, des subventions indirectes, les « pouvoirs publics » avaient investit 35 millions d’euros dans l’Automotive Park (le nouveau zoning destiné à accueillir les sous-traitants), des terrains de la STIB et de la SNCB avaient été mis à la disposition de ce projet (la SNCB investissant directement 70 millions d’euros pour une meilleure desserte du zoning), etc.
Cette forme d’intervention de l’Etat existe donc. Et il faut se demander si, vraiment, c’est une chose que l’on souhaite accroître, tant que l’on restera dans le système capitaliste. Car enfin, la concurrence aidant, l’Etat allemand, les chemins de fer allemands, etc. pourraient alors proposer deux fois plus aux constructeurs, et une surenchère se développerait, qui ne changerait rien au fonds du problème, mais qui impliquerait que la population (via ses impôts) offrirait des sommes de plus en plus extravagantes aux constructeurs pour qu’ils daignent ne pas fermer des usines qui leur rapportent déjà des milliards.
Dans le cadre du système capitaliste, cet appel général aux « pouvoirs publics » trahit donc une vue extrême courte.
Si l’on envisage une issue anti-capitaliste, cet appel à l’Etat (ou aux « pouvoirs publics ») trahit une vue plus courte encore, car il trahit l’illusion que ce pouvoir pourrait être autre chose que l’instrument d’une classe dominante qui ne vit que par le système capitaliste.
L’Etat bourgeois n’existe que pour permettre le bon fonctionnement du capitalisme. Les travailleurs peuvent arracher, par la lutte, des choses à cet Etat, comme il peuvent en arracher aux capitalistes, mais cela n’en fait pas un instrument au-dessus des classes, utilisable par les uns comme par les autres. Voir dans l’Etat autre chose qu’un instrument au service de la bourgeoise, et lui demander de se mettre au service du prolétariat, est une dangereuse absurdité qui ouvre la porte à tous les opportunismes et à toutes les trahisons. Seule la lutte du prolétariat donnera du pouvoir au prolétariat, et cela jusqu’au moment où, dans ce moment particulier de la lutte qu’est la révolution, elle lui donnera le pouvoir d’Etat.
Quant au « néolibéralisme », il n’est « que » la méthode qu’a choisie aujourd’hui la bourgeoisie pour assurer l’exploitation du prolétariat. C’est une méthode que les grands capitalistes, leurs plus célèbres économistes et des représentants des « pouvoirs publics » de monde entier affinent et redéfinissent dans des instances comme le Forum économique mondial (WEF), qui a lieu chaque année à Davos.
Depuis des années, le WEF (dont le groupe VW est un partenaire stratégique) est la cible des militants syndicaux, altermondialistes. On peut rappeler que c’est d’ailleurs dans le cadre des mobilisations anti-WEF que le siège de AMAG, l’importateur-distributeur de VW en Suisse, a été sévèrement vandalisé dans la nuit du 20 au 21 décembre, en solidarité avec les grévistes de VW-Forest.
Défini et redéfini d’année en année au WEF, le « néo-libéralisme » est la méthode actuelle de la bourgeoisie impérialiste, mais il n’est « que » cette méthode.
Il a été précédé d’une autre méthode et sera peut-être suivi d’une autre encore, qui reverrait, par exemple, les « pouvoirs publics » saigner les masses pour « intervenir » massivement dans l’économie. Il apparaîtra alors que le « néo-libéralisme » enterré, il ne faudra pas moins combattre la nouvelle méthode de la bourgeoisie, parce qu’elle couronnera, elle aussi, le processus d’exploitation capitaliste intrinsèquement contraire aux intérêts des masses. Fondamentalement, nous ne luttons pas contre le « néo-libéralisme », mais contre le capitalisme.
6. Limites des syndicats, limites du syndicalisme
Et cette lutte, les organisations syndicales ne pourront jamais l’assumer seules.
La corruption, la division, les trahisons, le corporatisme, etc. du monde syndical sont des maux bien réels, mais même épurés des traîtres et des corrompus, unis et homogènes, les syndicats resteraient toujours structurellement incapables d’autre chose qu’une défense plus ou moins efficace (selon les périodes) des intérêts immédiats du prolétariat, dans le cadre d’un système répondant objectivement à l’intérêt général de la bourgeoisie et du capitalisme.
Il faut faire une rigoureuse distinction entre le syndicalisme compris comme moyen de défense des intérêts immédiats des travailleurs et, d’autre part, l’option qui prétend faire du syndicalisme la base du progrès social, en l’inscrivant dans le projet réformiste.
Cette distinction est donc avant tout politique. On peut lutter de la même manière et pour un même objectif partiel (une augmentation de salaire, par exemple) dans des perspectives radicalement différentes : les uns considérant que la satisfaction de leur revendication constituera un petit pas de plus accompli dans le sens d’une transformation progressive et progressiste de la société, les autres jugeant qu’elle constituera seulement un acompte dans l’attente de l’essentiel, à savoir le pouvoir politique et la propriété sociale des moyens de production.
Ces deux conceptions opposées reflètent dans leur domaine la divergence entre le projet réformiste et le projet révolutionnaire. L’activité syndicale constitue naturellement un espace de lutte politique et idéologique entre ces deux projets.
Les révolutionnaires doivent pleinement soutenir les luttes syndicales pour la défense des intérêts immédiats des travailleurs. Mais ensuite, indissociablement, ils doivent porter la bataille politique et idéologique dans chaque lutte syndicale, en y défendant ouvertement le projet révolutionnaire contre le projet réformiste, en y appuyant toutes les tendances favorables à l’émergence ou au renforcement de la conscience de classe, de l’unité et de la solidarité prolétariennes, de la rupture avec les normes politiques, idéologiques, juridiques, etc. du régime bourgeois.
Faire de l’entrisme dans la CSC ou la FGTB revient à prendre place dans l’attelage de l’un ou l’autre char réformiste. Déclarer une guerre à outrance aux organisations syndicales est irresponsable puisque le mouvement révolutionnaire est actuellement incapable de défendre les intérêts immédiats les plus vitaux des travailleurs.
Les organisations syndicales en place représentent un garde-fou contre les exactions patronales et les mesures gouvernementales les plus brutales, en même temps qu’elles sont un agent de stabilité pour l’exploitation capitaliste dans son ensemble. Il faut donc, d’une part, éviter de renforcer l’emprise idéologique et politique des grandes organisations syndicales sur les masses. Il faut éviter, d’autre part, d’exercer une influence dissolvante sur les structures syndicales de base, parce qu’elles sont indispensables à la défense des intérêts immédiats des travailleurs
Concrètement, en tenant compte de la répression qui frappe les syndicalistes de lutte de classes, tant de la part de la justice bourgeoise (à laquelle le patronat a de plus en plus systématiquement recourt) que de la part de la bureaucratie syndicale (comme en témoignent l’exclusion des délégués de Clabecq, les purges de 2002-2003 dans la FGTB, et les intrigues actuelles contre quelques délégués de chez VW-Forest), l’expérience des Comités de Lutte Syndicale, qui connurent un certain succès dans la lutte ouvrière sous l’occupation nazie, doit recueillir une attention particulière.
Cette expérience a déjà été décrite en détail dans Clarté , nous n’en rappellerons ici que les grandes lignes.
Un Comité de Lutte Syndicale regroupe dans une même entreprise ou secteur : primo les syndicalistes de lutte de classes de tous les syndicats, secundo les travailleurs conscients et combatifs non-syndiqués (c’est le cas de nombreux travailleurs dégoûtés des syndicats), tertio les pensionnés, prépensionnés et chômeurs actif sur le front de la lutte de classes et ayant fait partie de l’entreprises ou du secteur dans le passé.
En raison des diverses formes de répressions , les Comités de Lutte Syndicale ont une vie semi-clandestine (leurs tracts peuvent être distribués aux portes de l’entreprise par des camarades travaillant ailleurs). Ils dénoncent les accords passés entre les patrons et la bureaucratie syndicale et proposent leurs propres mots d’ordre, en liaison étroite avec la réalité de l’entreprise ou du secteur, et en évitant soigneusement de tomber dans des travers corporatistes.
Seule l’interaction entre de tels Comités de Lutte Syndicale et un véritable parti révolutionnaire ouvrira des perspectives à la lutte du prolétariat.
Le devoir des communistes est, sinon de construire aujourd’hui ces comités et ce parti , au moins de réunir les conditions nécessaires à cette construction.
(rédaction Clarté )
La pauvreté de la scène militante belge (pas besoin d’être un oracle bien doué pour prédire que le 1er Mai bruxellois se bornera à une impuissante promenade au soleil suivie d’une vague kermesse) pourrait occulter à quel point la réalité est différente ailleurs en Europe. L’arrestation des militants du Parti Communiste Politico-Militaire (hériter des Brigades Rouges « seconde position ») fut ainsi suivies de centaines de manifestations de sympathie. La scène autonome berlinoise témoigne aussi d’une activité importante et totalement méconnue. Outre des manifestations de masse (ainsi le traditionnel 1er mai de Kreutzberg), ce sont des dizaines d’actions de guérilla « de basse intensité » qui sont menées chaque année.
On sait à quel point l’autonomie est une réalité complexe : son engagement de classe est conséquent mais son anti-léninisme n’en fait certainement pas, à nos yeux, un modèle. C’est néanmoins une réalité qui mérite que l’on force le black-out que les médias bourgeois font autour d’elle.
Une demi-douzaine de groupes composent l’aile clandestine de l’autonomie (le groupe « Klasse gegen Klasse », l’Autonome Miliz, l’Autonome gruppe/militant people, la Militante Antimilitaristische Initiative, les Internationalistische Zellen, les « Fight 4 revolution crews », etc.), mais le plus actif d’entre ces groupes reste le Militante Gruppe.
Ce « groupe militant » berlinois (le vocable « militant » a un sens plus fort en allemand qu’en français, une « action militante » a une dimension illégale et violente), qui édite une petite revue clandestine (« mg-express – Infos zu klandestiner Politik »), est apparu au grand jour en 2001 en incendiant plusieurs véhicules de la société Daimler-Chrysler, à Berlin.
Le MG se distingue à nos yeux dans les rangs de l’autonomie allemande en ce qu’il pose clairement le problème du défaut d’organisation de classe de ce mouvement. Un de ses mots d’ordre est « La militance sans organisation est comme le sel sans soupe ». Le fait qu’il propose et expérimente des éléments de solution doit être souligné, même s’il le fait à partir de l’expérience de l’autonomie plutôt que de l’expérience du marxisme-léninisme.
La principale forme d’action « militante » du MG est l’incendie d’immeuble ou de voitures.
On ainsi été visées :
– des entreprises capitalistes comme Daimler-Chrysler à Berlin-Mariefeld (juin 2001) et en Brandebourg (avril 2002), ALBA à Berlin-Reinickendorf (octobre 2003), Deutsche Telekom à Berlin-Wedding (mai 2004), Lidl à Berlin-Schoneberg (janvier 2005), FIAT à Berlin-Spandau (en solidarité avec les prisonniers des Brigades Rouges PCC), etc.
– des organismes du contrôle social comme l’Office social de Berlin-Reinickendorf (février 2002), l’Office du Travail de Berlin-Nord (mars 2004), l’Office social de Berlin-Pankow (mars 2004), l’Office social de Berlin-Temperlhoff (septembre 2004), l’Office social de Berlin-Schoneberg (septembre 2004), l’Office des étrangers (AzylbLG) à Berlin-Reinickendorf (septembre 2004), le Ministère du Travail et des affaires sociales (avril 2005), l’Agence pour l’emploi de Berlin-Potsdam (avril 2005), etc.
– d’autres institutions de l’Etat bourgeois comme l’Office des finances de Berlin-Neukolln. (décembre 2002), l’Institut Allemand pour la Recherche Economique, le DIW, à Berlin-Stoklitrz (incendié une fois en décembre 2003 et une seconde fois en novembre 2005), le parlement du Land de Brandebourg (avril 2005), etc.
– des organismes patronaux comme l’Association des investisseur turcs (mars 2006) et la Chambre de commerce italienne (mars 2007, en solidarité avec les prisonniers du Parti Communiste Politico-militaire), etc.
– la justice, la police et l’armée comme le Haute Cour et le parquet du Land de Saxe-Anhalt à Naumburg/S. (septembre 2003) ainsi que plusieurs véhicules de la police et de l’armée (en 2003, 2005 et 2006), etc.
Et cette liste est incomplète.
Pour permettre une meilleure connaissance de cette réalité militante dans un pays voisin, nous avons traduit un des communiqués du MG. Ce communiqué se rapporte à une action faite avant la grande manifestation du 3 juin 2006 contre le plan gouvernemental de régression sociale « Harz IV ».
Avec notre attaque incendiaire du Tribunal « social » berlinois dans la nuit du 24 mai 2006, nous avons continué notre offensive contre les institutions de la technocratie sociale. De plus, nous comprenons nos actions militantes comme un avertissement à ne pas laisser sans combat le développement de la manifestation pour la défense des acquis sociaux sociale du 3 juin, à Berlin, aux mains des Bsirske, Lafontaine et compagnie. Imprimons notre marque de manière incontournable : attaquons la technocratie sociale sur tous les plans militants, chassons de la scène les Lafontaine et C° !
Enfin, nous donnons avec cette action un avertissement sans ambiguïté à ces juges des tribunaux « sociaux » qui sont responsables des verdicts anti-prolétaires et qui, par là, poussent dans le néant les gens qui sont à la marge de la société. La fête est finie et ne pensez pas que vous pourrez vous cacher derrière vos paragraphes de merde ! En fin de compte, vous payerez la facture, vous pouvez graver cela sur vos montagnes de dossiers.
Dans ce cadre, nous voulons revenir sur les attaques directe et personnalisées contre le directeur d’Affiniere de l’Allemagne du Nord, Werner Marnette, et le chef de l’Institut de Recherche Economique de Hambourg (HWWI), Thomas Straubhaar [leurs voitures et/ou leur domicile avaient été incendiés peu auparavant, NdT]. Ces formes d’action contre les propriétés des technocrates sociaux diplômés montrent que, contrairement à ce que disaient les infos télévisés du magazine « Report Mainz » du 15 mai 2006, d’après lesquelles « cela peut arriver à tout le monde », ceux qui ont été la cible d’une action militante savent bien pourquoi le adresses était en tête de liste.
Aux tribunaux sociaux comme instrument du lutte de classe d’en haut…
Dans la foulée de l’attaque de classe d’en haut avec ses instrument bien connus que sont l’« Agenda 2010 » et les réformes « Hartz », une fonction de plus en plus importante est conférée aux tribunaux « sociaux ». Sur les tables des greffes des tribunaux « sociaux », s’empilent les contradictions et les plaintes contre les dégâts qui résultent par exemple de l’imposition de « Harz IV ». De plus, ces prochains mois, les premiers cas de menace de déménagement contraint des « Centres d’emploi » dans les bâtiments des tribunaux « sociaux » seront négociés. A cause de ce « surcroît de travail », ont a attribué davantage de personnel aux tribunaux « sociaux » : le nombre de places de juge dans le tribunal « social » berlinois a ainsi été augmenté d’un tiers. Une autre branche de l’ « administration de la misère » qui connaît un petit boom : la dégringolade dans l’échelle sociale des uns implique la promotion sociale des laquais de la bureaucratie de classe. La marginalisation sociale de larges cercles de la population et la paupérisation individuelle sont de moins en moins gérées et de plus en plus bétonnées par des tribunaux « sociaux ».
Les tribunaux « sociaux » sont un instrument du combat de classe d’en haut organisé, une institution qui appose un cachet sur l’appauvrissement individuel. C’est la dernière étape d’une longue chaîne de conflits avec l’appareil administratif des Centres d’emploi. Le rôle d’amortissement de l’état de bien-être social et la dissimulation du conflit de classe ne joueront plus aucun rôle si Hartz IV est imposé. La façade, si bien entretenue pendant des décennies, de l’idéal d’égalité sociale, s’effondre comme un château de carte. Ce qui règne est la violence froide et nue des représentants de la technocratie sociale. Notre devoir est de casser cette logique dominante d’après laquelle ils ceux qui s’attribuent le pouvoir définissent le droit.
… opposer la résistance sociale révolutionnaire organisée !
Il n’existe pas d’automatisme qui donne aux personnes paupérisées et maltraitées une perspective collective de combat de classe, et qui conduit, comme si cela allait de soi, à l’action directe. Néanmoins, dans les dernières années de la confrontation aux agences de la technocratie sociale, beaucoup d’initiatives et de projets sont nés qui ont donné du courage au mouvement. Nous devons immédiatement partir de ceci pour donner des exemples et pour développer un cadre qui permet une participation des personnes socialement marginalisées et précarisées. Pour notre part, depuis que nous existons, nous avons misés sur les « trois volets » de l’organisation en des structures de groupes militants (plate-forme militante), du soutien et de la co-initiations des processus de base, et sur la création des conditions logistiques d’une propagande armée sous la forme organisationnelle d’une structure de guérilla ou de milice. Dans le cadre d’un processus de construction révolutionnaire aussi complexe, nous voyons un déclencheur pour sortir le combat du communisme du cabinet de l’écrivain et l’amener au grand jour, dans les rues et la vraie vie.
Dans ce contexte nous comprenons notre intervention militante comme un conseil d’orientation sur la manière dont on pourrait, par exemple, transformer la manifestation du 3 juin à Berlin contre le hold-up social, pour éviter qu’elle ne sombre dans le chenal de la compromission de classe des apparitchiks du DGB et batteurs d’estrades du Parti de « gauche ». La bureaucratie syndicale ainsi que les nouveaux partis politiques comme la WASG, qui se dirigent volontairement dans la nasse du parlementarisme, ne sont pas et n’ont jamais été des partenaires d’une alliance pour une gauche révolutionnaire, mais sont notoirement les hommes du statu quo, qui ont toujours dénoncé la résistance sociale révolutionnaire comme un « facteur de trouble ».
Pour une plate-forme – pour un processus de construction révolutionnaire – pour le communisme !
militante gruppe (mg), 23 mai 2006.
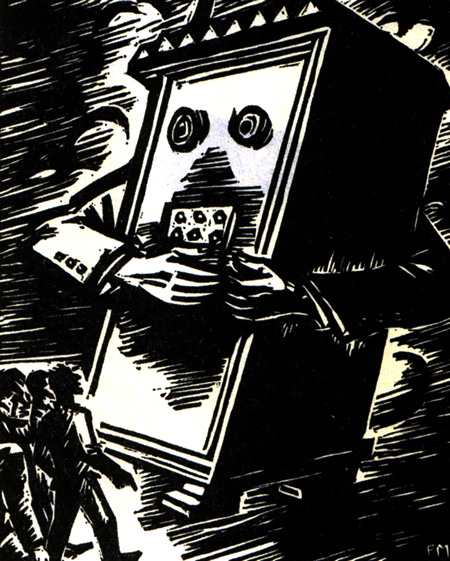
Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu’il a créé s’est fondu.
En décrétant qu’on le lui rende
Le peuple ne veut que don dû.
Introduction
Une note en bas de page du texte de la conférence consacrée aux Catégories de la politique militaire révolutionnaires a provoqué une réaction assez vive du camarade Maj, la délégation de la Commission Provisoire du Comité Central du (n)PCI. Nous publions très volontiers cette lettre, et irons même au delà des désirs exprimés dans cette lettre en publiant, dans un prochain numéro de Clarté un des documents cités comme référence par notre correspondant.
Ceci étant, et conformément à la vocation de Clarté qui est une confrontation des idées dans le cadre des principes et méthodes du marxisme-léninisme, nous donnerons une nouvel espace à la critique du discours stratégique du (n)PCI en accompagnant ce texte d’une lecture critique.
Lettre ouverte à la rédaction de Clarté
Nous avons lu dans le n°6 (décembre 2006) de Clarté page 33, à propos de nos positions sur la guerre populaire révolutionnaire de longue durée (GPRdeLD) dans les pays impérialistes et nommément en Italie, que « selon la confiance que l’on accord à l’honnêteté révolutionnaire du (n)PCI, il s’agit là soit d’un abus de langage (la guerre se caractérisant, comme l’expose Clausewitz, par l’usage du combat armé), soit d’une escroquerie politique ». Dans le numéro précédent de Clarté vous vous étiez proposé d’étudier notre thèse selon laquelle la conquête du pouvoir en Russie par les bolcheviks avait suivi le schéma de la GPRdeLD. Nous pensions que vous auriez partagé avec vos lecteurs les motivations des conclusions de votre étude. D’autant plus si la conclusions est celle que nous trouvons dans le numéro 6 de Clarté : on ne porte pas des accusations di graves sans les justifier. De toute façon nous vous demandons, comme démonstration de votre honnêteté révolutionnaire, de publier dans le prochain numéro de votre revue cette lettre avec la remarque suivante.
Clausewitz a été un remarquable théoricien de la guerre. Mais il n’est pas le seul. Vous savez bien qu’il a été contesté par plusieurs personnes, entre autres par ces communistes qui ont défendu la thèse que « chaque classe a sa théorie de la guerre » , que « chaque classe fait la guerre à sa façon » , « qu’il n’y a pas une théorie de la guerre valide pour la bourgeoisie et pour le prolétariat » . En Union Soviétique, au début du pouvoir soviétique, les partisans de ces thèses (Staline parmi les plus célèbres) se sont confrontés avec ceux qui défendaient la thèse que la science est au dessus des divisions de classe (Trotski parmi les plus célèbres). Nous partageons les thèses de Staline. Qui fut aussi la thèse de Mao. La guerre entre la bourgeoisie et la classe ouvrière est un affrontement pour le pouvoir. La bourgeoisie veut conserver le pouvoir. La classe ouvrière veut prendre le pouvoir. Il s’agit d’un affrontement entre deux camps. L’une a un Etat consolidé par une longue tradition et soutenu par la « société civile ». La seconde doit édifier en combattant son Etat et le support social de son Etat : le parti communiste, le front des forces et des classes révolutionnaires, les forces armées. Normalement, au commencement de sa lutte, il n’a pas encore de forces armées.
Nous appelons « guerre » cet affrontement : guerre populaire révolutionnaire de longue durée. Car il s’agit d’un seul processus (bien qu’il s’accomplisse par étapes qu’il faut distinguer). Car il s’agit de l’affrontement de deux pouvoirs antagoniques dont l’un doit éliminer l’autre. Vous dites que « la guerre est de toute façon la guerre » . Qu’il s’agit de la même chose pour toutes les classes, caractérisée « par l’usage du combat armé » . Nous disons que la guerre menée par la bourgeoisie est une chose et la guerre menée par le prolétariat est une autre chose (asymétrie). Qu’il s’agit de deux phénomènes différents, qui suivent des lois différentes. Est-ce qu’il y a là lieu à parler d’abus de langage ou d’escroquerie ? Nous pensons qu’il faut étudier honnêtement les propositions des adversaires, avant de les insulter et calomnier. Donc nous signalons aux lecteurs de Clarté les principaux articles dans lesquels nous avons exposé nos conceptions à propos de la guerre populaire révolutionnaire de longue durée dans les pays impérialistes. Malheureusement la plus grande partie ne sont pas encore traduit en français. Sulla forma della rivoluzione proletaria (in La Voce n.1, marzo 1999, pag. 23-35); L’ottava discriminante di Nicola P. (in La Voce n.10, marzo 2002, pag. 19-42); L’attività della prima Internazionale Comunista in Europa e il maoismo di Umberto C. (in La Voce n.10, marzo 2002, pag. 52-59), Lotta politica rivoluzionaria e lotte rivendicative di Nicola P. (in La Voce n. 14, luglio 2003, pag. 49-59), Politica rivoluzionaria di Ernesto V. (in La Voce n.15, novembre 2003, pag.60-69), Bisogna distinguere leggi universali e leggi particolari della guerra popolare rivoluzionaria di lunga durata di Umberto C. (in La Voce n. 17, luglio 2004, pag. 19-36), Bisogna rielaborare le esperienze del passato ed elaborare le esperienze presenti alla luce della teoria della guerra popolare rivoluzionaria di lunga durata di Umberto C. (in La Voce n. 17, luglio 2004, pag. 19-36); Bisogna rielaborare le esperienze del passato ed elaborare le esperienze presenti alla luce della teoria della guerra popolare rivoluzionaria di lunga dirata di Tonia N. (in La Voce n. 18, novembre 2004, pag. 19-36). Voir http://lavoce-npci.samizdat.net section française de EiLE]. Selon nous, les relations parmi les communistes doivent se baser sur la connaissance réciproque, sur la critique franche et fraternelle, sur la solidarité face à la répression. Nous souhaitons que aussi la rédaction de Clarté pratique cette approche.
Salutations.
Giuseppe Maj — Pour la Delegazione della Commissione Provvisoria del Comitato Centrale
(nuovo)Partido comunista italiano
Éléments de réponse à la Lettre ouverte
« Assez de ce langage de fusil rouillé ! »
Aragon, Traité du style
La prochaine publication du document du (n)PCI et de sa lecture critique me dispense d’aborder la doctrine militaire de ce parti. Je me bornerai ici à la question de l’analyse « de classe » de la guerre. T. D.
1. Deux questions et quelques confusions
La Lettre ouverte présente Clausewitz comme le représentant de la pensée de la guerre bourgeoise, à laquelle nous devrions opposer une pensée de la guerre prolétarienne. Ce qui pose deux questions :
1° Dans quelle mesure y a-t-il une théorie bourgeoise de la guerre et une théorie prolétarienne de la guerre ?
2° Doit-on considérer Clausewitz comme le simple représentant de cette [éventuelle] théorie bourgeoise de la guerre ?
« Nous disons que la guerre menée par la bourgeoisie est une chose et la guerre menée par le prolétariat est une autre chose (asymétrie). Qu’il s’agit de deux phénomènes différents, qui suivent des lois différentes. » Certaines vérités cessent d’être vraies lorsqu’on s’y limite. Il s’agit bien « de deux phénomènes différents » , mais il s’agit dans le même temps des deux aspects (contradictoires) d’un seul et même phénomène dialectique : la guerre où s’affrontent prolétariat et bourgeoisie. Et ce phénomène est partie d’un phénomène plus large encore, celui de guerre des classes (1), qui fait lui-même partie d’une catégorie plus large encore : celle de la guerre « en général ». Car la guerre révolutionnaire est une guerre ; c’est même, comme l’a dit Camille Rougeron, « le dernier terme de cette évolution qui a conduit de la chevalerie à la guerre totale en passant par l’armée de métier et la nation armée. »
Le prolétariat ne fait pas la guerre comme la bourgeoisie (tout comme la bourgeoisie n’a fait pas la guerre à la manière de la noblesse féodale). En énonçant cette évidence, la lettre trahit une confusion entre la théorie de la guerre prolétarienne et la théorie prolétarienne de la guerre . Plus exactement, la Lettre ouverte mélange trois niveaux d’analyse :
1° le point de vue du prolétariat dans la guerre qu’il mène, à un moment donné et dans des circonstances données, contre la bourgeoisie — point de vue qui reflète et détermine sa manière de faire la guerre, et qui est un mélange d’analyse révolutionnaire, de traditions de lutte, d’idéologie de classe, de caractères dictés par des éléments contingents, etc. (2) ;
2° le point de vue prolétarien (marxiste) sur la guerre de classe — point de vue nourrit par le matérialisme historique, qui permet aux avant-gardes politiques de la classe à avoir du recul sur sa manière de mener sa guerre, à avoir une certaine compréhension du point de vue de la bourgeoisie (parfois supérieure à la vision qu’en a la bourgeoisie elle-même), etc. ;
3° le point de vue prolétarien (marxiste) sur la guerre « en général », son origine, ses lois, etc.
A chaque niveau d’analyse (guerre prolétarienne, guerre de classe, guerre « en général »), il y a un point de vue prolétarien et un point de vue bourgeois. Mais, primo , à l’intérieur même de chacun de ces niveaux, cette distinction n’est pas partout opérante, et secundo , mélanger ces niveaux produit à coup sûr de lourdes erreurs.
2. Premier niveau : théorie de la guerre prolétarienne
Il s’agit du point de vue du prolétariat dans la guerre de classe, point de vue qui détermine, (sous l’influence des conditions objectives et subjectives), sa manière de mener cette guerre. Il me semble que la Lettre ouverte commet sur ce point deux erreurs.
1° L’erreur de considérer que chaque « point de vue » de classe (et donc la manière de faire la guerre) est lié de manière exclusive aux éléments conscients de cette classe. Il est évident, au contraire, que le prolétariat peut (et doit) analyser le point de vue bourgeois, et que les stratèges bourgeois ne se privent pas d’étudier le point de vue prolétarien dans la guerre — à chaque fois pour mieux combattre l’adversaire. La « théorie de la guerre prolétarienne » n’est donc pas le domaine réservé de l’intelligence prolétarienne : les théoriciens bourgeois de la guerre peuvent l’étudier (avec leurs limites idéologiques), dans le cadre de la science militaire (3).
2° L’erreur d’établir cette double équivalences : guerre bourgeoise = guerre contre-insurrectionnelle, et guerre prolétarienne = guerre insurrectionnelle. La Lettre ouverte généralise abusivement une situation donnée, savoir celle où « La bourgeoisie veut conserver le pouvoir. La classe ouvrière veut prendre le pouvoir. (…). L’une a un Etat consolidé par une longue tradition et soutenu par la « société civile ». La seconde doit édifier en combattant son Etat et le support social de son Etat : le parti communiste, le front des forces et des classes révolutionnaires, les forces armées. »
Or, la bourgeoisie a mené des guerres révolutionnaires et insurrectionnelles (contre les armées d’Ancien régime), et le prolétariat a mené des guerres contre-insurrectionnelles (4). De plus, prolétariat et bourgeoisie ont mené des guerres qui n’étaient ni insurrectionnelles ni contre-insurrectionnelles : des guerres classiques où s’affrontaient régiments, divisions et corps d’armée de chaque camp. Et comme à chaque fois dans l’analyse il faut multiplier les allers-retours entre généralisation et distinction, remarquons qu’il s’agit d’étapes d’un même processus : en 1917-18, le prolétariat mène une guerre insurrectionnelle et la bourgeoisie une guerre contre-insurectionnelle ; en 1918-19, l’Armée rouge remplace la garde rouge et la guerre évolue en guerre classique ; après 1920 (défaite de l’armée Wrangel) le prolétariat mène une guerre contre-insurectionnelle et la bourgeoisie une guerre insurrectionnelle.
Ce n’est pas un hasard si les débats (évoqué dans la Lettre ouverte ) sur la « théorie prolétarienne de la guerre » soient apparu au moment où la guerre de classe changeait non pas de caractère (de classe) mais de catégorie : Trotski et Staline se sont opposés sur cette question en 1918-1919 au moment où le prolétariat passait de la guerre insurrectionnelle à la guerre classique (5).
3. Deuxième niveau : théorie prolétarienne de la guerre de classe
Dans l’analyse de la guerre de classe, il y a clairement un point de vue prolétarien et un point de vue bourgeois, celui-ci se caractérisant par la négation du caractère de classe de la guerre. Là où l’analyse marxiste verra des avant-gardes du prolétariat inscrivant sur le terrain militaire le devenir historique de classe (devenir déterminé par ce qui caractérise la classe : sa place dans le mode de production), l’analyse bourgeoise verra des « terroristes » ou des « rebelles » essayant d’entraîner les citoyens dans un projet subversif. Les rares théoriciens bourgeois qui verront une guerre de classe dans la guerre de classe, l’interprèteront avec des catégories prémarxistes (« pauvres » contre « riches », par exemple).
Cet handicap idéologique grève la pensée militaire bourgeoise. Les guerres insurrectionnelles prolétariennes sont traitées par elle dans la même catégorie (celle des « guerres irrégulières ») que les guerres insurrectionnelles bourgeoises (celle de la Contra au Nicaragua, par exemple). Les similitudes tactiques et techniques leur masquent la différence fondamentale qui procède du lien entre l’initiative combattante et les intérêts historiques des masses.
4. Troisième niveau : théorie prolétarienne de la guerre
Y a-t-il une conception prolétarienne (marxiste) particulière du phénomène « guerre » dans toutes ses manifestations ? « Dans toutes ses manifestations », cela veut dire primo pour toutes les guerres (guerres prolétariennes et guerres bourgeoises, mais aussi guerres primitives, guerres antiques, guerres féodales, guerres dynastiques, guerres nationales, guerre atomique, etc.), et secundo , dans tous les domaines (science de la guerre, art de la guerre, stratégique, opératique, tactique, technique, polémologie, histoire des conflits et des doctrines, etc.).
Dans les aspects pratiques les plus élémentaires du phénomène, il n’y a guère de différence : il n’y a pas une manière bourgeoise et une manière prolétarienne de creuser une tranchée ou de tirer à la mitrailleuse. Par contre, au plus haut niveau de conceptualisation, la différence est nette. Premier exemple : l’origine du phénomène. Le prolétariat fait découler la guerre de l’apparition de la propriété privée, la bourgeoise d’une « nature humaine », immuable et anhistorique. Autre exemple : l’utilisation systématique de la catégorisation guerre juste/guerre injuste, formulée par Lénine, systématisée par Staline et Mao (6).
Les différences entre les conceptions bourgeoises et prolétariennes de la guerre ne découlent pas directement de la situation politique des classes belligérantes (classe au pouvoir, ou classe luttant pour le pouvoir). Elles découlent de leur vision du monde, c’est-à-dire aussi bien de leur base idéologique que de leurs connaissances positives.
Les écoles bourgeoises, qui se privent pour des raisons idéologiques de l’instrument du matérialisme historique, ont été dépassées par les écoles prolétariennes. Mais ce fut un pur dépassement dialectique, à la fois fondé sur la prise en compte d’un héritage et sur la critique de celui-ci. Ce dépassement n’avait pas besoin de réinventer, disons, les principes de la balistique, mais il permet une représentation plus exacte des réalités sociales et historiques. La lecture de Clausewitz par Lénine est éclairante. Lénine se met à l’école de Clausewitz. Lénine a totalement fait sienne la théorie de la guerre de Clausewitz, mais il l’enrichit, grâce au marxisme.
Cet enrichissement a parfois profité à la bourgeoisie, quand elle était en mesure de le reconnaître. Ainsi, lorsque les académies militaires de l’Armée rouge formulent le concept d’art opératif, elles enrichissent considérablement l’art de la guerre « en général » et ce concept sera repris peu à peu par toutes les armées bourgeoises.

Les Rois nous soûlaient de fumées,
Paix entre nous, guerre aux tyrans !
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l’air et rompons les rangs !
S’ils s’obstinent, ces cannibales,
A faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.
5. Pour Clausewitz
Il ne faut donc pas étroitement caractériser Clausewitz comme le représentant d’une « théorie bourgeoise de la guerre » qui ne nous intéresserait qu’à titre de documentation sur les idées de nos ennemis de classe. Clausewitz, comme tout grand scientifique et tout grand philosophe, a fait progresser la compréhension du monde. Sa célèbre formule « la guerre est la continuité de la politique par d’autres moyens » n’est pas une formule « bourgeoise » ou « prolétarienne ». Elle a été assumée par Lénine comme rendant parfaitement compte du phénomène « guerre ».
Bien entendu, la pensée de Clausewitz est marquée par sa classe (7). Mais grâce à son esprit scientifique, son tour de pensée dialectique, et son méthodisme, Clausewitz a pu s’affranchir dans une mesure assez remarquable des œillères de sa classe.
Il y a un lien historique entre Clausewitz et la théorie bourgeoise de la guerre. Clausewitz a effectivement joué un grand rôle dans le développement de cette théorie. Mais exciper ce lien pour disqualifier les catégories de Clausewitz est abusif. Et lorsque l’on fait une confusion entre théorie bourgeoise de la guerre et théorie de la guerre bourgeoise , on s’expose à des erreurs plus graves encore.
Clausewitz a fourni un immense effort de conceptualisation. Sa caractérisation, remarquablement synthétique et efficace, de la guerre par l’usage du combat armé, est fondée sur une conscience très vive du nombre infini des manifestations du phénomène « guerre », et de son caractère sans cesse changeant (8).
6. L’argument d’autorité
La Lettre ouverte recourt à l’argument d’autorité et invoque Staline et Mao. Une fois dissipée la confusion entre théorie de la guerre prolétarienne et théorie prolétarienne de la guerre , il s’agit de savoir si nous devons, avec Clausewitz, caractériser la guerre par son moyen (le combat « armé », « physique », « violent », « sanglant »), où si les classiques du marxisme-léninisme proposent un autre point de vue.
Lénine : « « La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens » (à savoir : par la violence). Cette sentence célèbre appartient à Clausewitz, l’un des auteurs les plus compétents en matière militaire. Les marxistes ont toujours considéré avec juste raison cette thèse comme la base théorique des conceptions sur le rôle de chaque guerre donnée. » (9)
Lénine encore : « Le marxisme se tient sur le terrain de la lutte de classes, et non de la paix sociale. Dans certaines périodes de crises aiguës, économiques et politiques, la lutte de classes aboutit dans son développement à une véritable guerre civile, c’est-à-dire à une lutte armée entre deux partie de la population. » (10)
Staline qui rejetait Clausewitz comme autorité militaire, n’en approuvait pas moins la définition clausewitzienne de la guerre : « Il [Lénine] louait Clausewitz avant tout, parce que, le non-marxiste Clausewitz, faisant en son temps autorité en tant que connaisseur des affaires militaires, confirmait dans ses travaux la célèbre thèse marxiste qu’entre la guerre et la politique il existe une relation directe, que la politique engendre la guerre, que la guerre est la continuité de la politique par des moyens violents. » (11)
Mao : « Là, [dans les démocraties bourgeoises] les formes d’organisations sont légales, les formes de la lutte, non sanglantes (pas de recours à la guerre). Dans la question de la guerre, le parti communiste lutte contre toute guerre impérialiste menée par son pays ; si une telle guerre éclate, sa politique vise à la défaite du gouvernement réactionnaire de son propre pays. Il ne veut pas d’autres guerre que la guerre civile à laquelle il se prépare. (…) En Chine, la forme principale de la lutte, c’est la guerre, et la forme principale de l’organisation, l’armée. Toutes les autres formes, par exemple l’organisation et la lutte des masses populaires,sont extrêmement importantes, absolument indispensables et ne sauraient en aucun cas être négligées, mais elles sont toutes subordonnées aux intérêts de la guerre. Avant que la guerre n’éclate, toute le travail d’organisation et toutes les luttes ont pour but de préparer la guerre. (…) En Chine, sans la lutte armée, il n’y aurait pas de place pour le prolétariat et le Parti communiste, et il leur serait impossible d’accomplir aucune tâche révolutionnaire. Notre Parti n’a pas suffisamment compris cette vérité durant les cinq ou six années qui séparent sa fondation en 1921 de sa participation à l’Expédition du Nord en 1926. A cette époque, on ne comprenait pas encore l’exceptionnelle importance de la lutte armée en Chine, on ne s’occupait pas sérieusement de la préparation à la guerre et de l’organisation de l’armée, on n’accordait pas une attention sérieuse à l’étude de la stratégie et de la tactique militaires.» (12)
Les classiques du marxisme-léninisme sont unanime : la guerre est la prolongation de la politique par des moyens violents, sanglants, armés ; la préparation de la guerre n’est pas la guerre. Lukacs : « La guerre n’est, d’après la définition de Clausewitz, que la continuation de la politique, mais elle l’est effectivement à tous égards . C’est-à-dire que la guerre signifie non seulement pour la politique extérieure d’un Etat que la ligne suivie jusque-là par le pays en temps de « paix » est menée jusqu’à son ultime conséquence, mais que la guerre exacerbe au plus haut point dans la différenciation des classes d’un pays (ou du monde entier), les tendances qui, déjà en temps de « paix » se sont manifestées activement au sein de la société. La guerre ne crée donc pas une situation absolument nouvelle, ni pour un pays, ni pour une classe à l’intérieur d’une nation. Son apport nouveau consiste simplement à transformer qualitativement l’intensification qualitative extraordinaire de tous les problèmes et c’est en cela, et uniquement par cela, qu’elle crée une situation nouvelle. (…) L’enlisement de l’ancienne Internationale dans les marais de l’opportunisme est la conséquence d’une période dont le caractère révolutionnaire n’était pas visible en surface. Son effondrement, la nécessité d’une nouvelle Internationale sont le signal de l’entrée désormais inévitable dans la période des guerres civiles. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille combattre dès maintenant et tous les jours sur les barricades. Mais bien plutôt que cette nécessité peut se faire jour dès demain et à chaque instant, bref que l’histoire a mis la guerre civile à l’ordre du jour. Et un parti prolétarien, et a fortiori une Internationale, ne peuvent être viables que s’ils reconnaissent clairement cette nécessité et sont décidés à préparer le prolétariat à cette nécessité et à ses conséquences, sur les plans moral et matériel théorique et organisationnel. Cette préparation doit avoir comme point de départ la compréhension du caractère de cette période. Ce n’est que lorsque la classe ouvrière aura reconnu la guerre mondiale comme conséquence nécessaire du développement impérialiste du capitalisme, ce n’est que lorsqu’elle aura compris que la guerre civile est sa seule résistance possible à son anéantissement progressif au service de la bourgeoisie, que la préparation matérielle et organisationnelle de cette résistance peut commencer. » (13)
Sur cette question, Trotski ne se distingue en rien : « La vérité est que la guerre civile constitue une étape déterminée de la lutte de classes, lorsque celle-ci rompant les cadres de la légalité vient se placer sur le plan d’un affrontement public et dans une certaine mesure physique des forces en présence. (…) cela est plus large que l’insurrection et tout de même infiniment plus étroit que la notion de la lutte de classes qui passe à travers toute l’histoire de l’Humanité. (…) Encore une fois la guerre civile n’est que la continuation violente de la lutte des classes. Quant à l’insurrection elle est la continuation de la politique par d’autres moyens. C’est pourquoi on ne la peut comprendre que sous l’angle de ses moyens. » (14) Même unanimité du côté de la réaction, de Carl Schmitt ( « La guerre est une lutte armée entre unités politiques organisées, la guerre civile est une lutte armée au sein d’une unité politique » (15)) au maréchal Montgomery ( « La guerre est un conflit armé d’une certaine durée entre des groupes politiques rivaux ; elle comprend l’insurrection et la guerre civile, mais exclut les émeutes et les actes de violence individuels. » (16)).
7. De la guerre
Mais la réalité est en mouvement et cette parfaite unanimité pourrait ne pas régler la question. Après tout, nous ne discutons pas ici pour confondre notre correspondant mais pour essayer de progresser dans notre compréhension du problème. La question que nous pourrions alors nous poser est : sur base de quelle analyse pourrait-on parler de « guerre sans affrontement armé » ?
L’extension du concept n’est pas rare dans le langage courant. Le mot « guerre » y a subi ce processus bien connu qui fait que les expressions les plus fortes se généralisent et se démonétisent. Par effet rhétorique, toute confrontation devient « guerre » et on parle ainsi de « guerre des prix » , de « guerre des nerfs » , de « guerre douanière » , etc. Tout le monde comprend que l’on parle d’un affrontement ou d’une rivalité particulièrement vive, et tout le monde comprend en même temps qu’il s’agit d’une hyperbole. Ce n’est donc pas de ce côté que l’on pourrait définir la guerre par autre chose que l’usage du combat.
Dans l’histoire de la théorie militaire, l’extension du concept de guerre au-delà de l’affrontement armé n’est pas sans précédent. Sauf erreur, la plus ancienne est celle d’Alexandre Svietchine (17) (et sa « stratégie intégrale »), la plus récente celle Qiao Liangh et Wang Xiangsui (et leur « guerre hors limites »).
Dans les années ’20 en effet, la science militaire soviétique proposait une abolition des catégories de guerre et de paix dans le cadre d’une stratégie militaire et politique, incluant les décisions économiques, politiques, économiques, diplomatiques, militaires etc. L’aboutissement doctrinal de cette tendance a été la théorisation par Alexandre Svietchine, en 1926, de la « stratégie intégrale », c’est-à-dire incluant tous les facteurs non-militaires (18).
En 1999, deux colonels de l’armée de l’air chinoise ont publié une analyse pour servir une réorientation de la doctrine militaire chinoise au regard des leçons des guerres de Yougoslavie et du Golfe. Ils proposent de substituer à l’ancienne définition de la guerre ( « faire usage de la force armée pour obliger un ennemi à se plier à sa propre volonté » ) celle-ci : « utiliser tous les moyens, dont la force armée ou la force non armée, militaire ou non militaire et des moyens létaux ou non létaux, pour obliger l’ennemi à se soumettre à ses propres intérêts » (19).
Mais ces deux exemples étendent le domaine de la guerre en associant au combat armé d’autres moyens (actions subversive, psychologique, économique, etc.). Le combat armé cesse d’être l’unique, voire même le principal moyen de la guerre, mais Svietchine (20) n’évoque pas (à notre connaissance) de « guerre sans combat armé ». Et si cela n’est pas inconcevable chez Qiao Liangh et Wang Xiangsui, ceux-ci remplacent simplement la force armée par d’autres moyens de destruction (piratages informatiques, mouvements de capitaux provoquant des crises boursières et financières, etc. (21)) (22).
Reste une autre manière d’aborder le problème. Le prolétariat et la bourgeoisie sont dans un rapport social antagonique dont la guerre est l’aboutissement historiquement nécessaire. Dans la lutte entre ces classes, même lorsque la guerre n’est pas pratiquée, elle en constitue toujours la perspective, la toile de fond, le point de mire. On peut alors dire, dans ce cas, que « la politique est la continuité de la guerre par d’autres moyens » (23). Mais ici encore, cela n’autorise pas à nier la spécificité de la guerre.
8. Conclusion (ou retour au point de départ)
L’absence de guerre ne signifie pas l’absence de lutte, mais simplement le non usage (éventuellement provisoire) du combat armé dans la gestion des contradictions d’intérêts. De ce point de vue, la paix comme la guerre sont deux moments de la lutte, et c’est ce que disait le très clausewitzien maréchal Chapochnikov : « Si la guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens, la paix n’est, elle aussi, que la continuation de la lutte par d’autres moyens » . De ce point de vue encore, la préparation de la guerre n’est pas la guerre, mais est un moment de la lutte, et si le (n)PCI avait simplement déclarer « lutter », ou même « préparer la guerre », plutôt que de prétendre « faire la guerre », cette polémique n’aurait pas existé.
La question que l’on ne peut manquer de se poser est alors : pourquoi le (n)PCI, Rossoperaio, et quelques autres s’obstinent à se dire en « guerre » à l’encontre des catégories de Clausewitz, de Lénine-Staline-Mao, du bon sens et des dictionnaires ?
On a le droit de contester la définition clausewitzienne de la guerre, assumée par Lénine et universellement reconnue, mais le strict minimum est alors de nous en proposer une autre, au moins aussi valable. Sans quoi, le (n)PCI, Rossoperaio et tous ceux qui prétendent « faire la guerre » depuis des années sans avoir tiré le moindre coup de fusil, ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes si on les soupçonne d’intentions cachées …
Car cette obstination fait supposer un enjeu important. Là commence « l’ère du soupçon », dont le (n)PCI ne pourra vraiment se plaindre qu’après avoir bien réfléchit à la manière dont il la provoque. Le propre de ces soupçons est d’être sans preuve. Ils découlent d’un vilain mélange d’éléments subjectifs et objectifs, dans lequel la confiance ou la défiance qu’inspire le (n)PCI joue un rôle central :
— La défiance amènera à soupçonner que, si le (n)PCI parle de « guerre » pour caractériser une lutte qui n’en est pas une, c’est dans le but de se bénéficier du prestige de la guerre révolutionnaire sans s’exposer aux risques de la pratiquer.
— La confiance amènera à penser que, si le (n)PCI parle de « guerre » pour caractériser une lutte qui n’en est pas une, c’est pour montrer sa détermination à s’engager dans le processus révolutionnaire jusque dans sa phase armée, et/ou pour défendre dès maintenant la thèse de la « guerre révolutionnaire de longue durée ».
Bref, comme le disait trop lapidairement la note de la Conférence qui a provoqué la Lettre ouverte : soit une escroquerie, soit un abus de langage.
T. D.
NOTE :
(1) Qui comprend également les guerres serviles, les guerres qui ont opposés la bourgeoisie aux classes dominantes du régime féodal, etc.
(2) Remarquons que ceci concerne également les guerres et soulèvements prolétariens antérieurs à l’élaboration et à la popularisation du marxisme. Mais nous ferons abstraction dans ce débat des idées pré-marxistes relatives à la guerre prolétarienne.
(3) Et plus précisément dans son volet concernant les « guerres irrégulières ».
(4) Pour la période 1919-1923 : contre la Makhnovchtchina en Ukraine, contre les cosaques blancs du Don, contre les soulèvements paysans de Tambov, Tioumen et Tobolsk, contre les marins révoltés de Cronstadt, contre les basmachis du Turkestan, etc.
(5) C’est l’époque de la lutte contre le « partisianisme » ( partizanchtchina ) dont l’exemple type était la 9e Armée rouge, composée de trois divisions qui, en 1919, faisaient chacune campagne en Ukraine de manière indépendante.
(6) Bien sûr, Lénine ne fut pas le premier distinguer « guerre juste » et « guerre injuste » (on trouve déjà cela chez Saint Augustin), mais Lénine a établi une corrélation scientifique entre le caractère juste de la guerre (sa conformité avec le processus historique de libération des peuples du capitalisme et de l’impérialisme) et ses perspectives de victoire. Avant cela, les seuls avantages que les théoriciens concédaient au camp qui menait une guerre juste était que le moral de ses combattants était supérieur et/ou que Dieu bénissait ses entreprises.
(7) Non pas la bourgeoisie, comme l’avance la Lettre ouverte, mais la petite noblesse fonctionnarisée.
(8) Clausewitz a eu l’avantage d’avoir observé au plus près le bouleversement résultant de la Révolution française. Encore fallait-il en tirer les justes conclusions, ce que furent loin de faire tous ses contemporains, qui n’ont pas su voir l’émergence de la guerre nationale derrière le « génie » de Bonaparte.
(9) Lénine : Le socialisme et la guerre , Éditions du progrès, Moscou, 1967, p.13.
(10) Lénine : Sur la guerre des partisans , in recueil Marx/Engels/Lénine/Staline La lutte des partisans, Union Générale d’Édition, collection 10/18 n°919, Paris, 1975, p. 82.
(11) Staline : Lettre au colonel Razine, Œuvres, tome XVI, Nouveau Bureau d’Édition, Paris, 1975, p. 453.
(12) Mao Zedong, Problèmes de la guerre et de la stratégie, in Œuvres Militaires , Éditions en Langues étrangères, Pékin, 1968, p.306-307.
(13) Georges Lukacs, La pensée de Lénine — L’actualité de la révolution, Éditions Denoël/Gonthier, collection Bibliothèque médiations n°92, Paris, 1972, pp. 73-74 et 82-83.
(14) Léon Trotsky, Les problèmes de la guerre civile (conférences faites à la Société des Sciences Militaires de Moscou le 29 juillet 1924). Texte intégral sur www.marxists.org.
(15) Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, Éditions Flammarion, collection Champs N°259, Paris, 1992, p. 70.
(16) Maréchal Montgomery, Histoire de la guerre , Éditions France Empire, Paris, 1970, p. 14-15.
(17) On transcrit aussi souvent : Svetchine.
(18) La doctrine de la « guerre totale » de Ludendorff reste en deçà des théories de Svietchine en ce qu’elle signifie fondamentalement subordination de toutes les ressources et énergies nationales à la guerre (celle-ci restant comprise comme activité militaire). Néanmoins, la « stratégie intégrale » de Svietchine apparaît à une époque où les leçons de la guerre totale de 14-18 poussent à l’élargissement de l’horizon stratégique : cf. la « grande stratégie » de Liddell Hart, la « stratégie générale » de l’amiral Castex, la « stratégie élargie » de Hitler, etc.
(19) Quiao Liang, Wang Xiangsui, La guerre hors limites , Payot/Rivage, Paris, 2006, p. 31-31 et 95.
(20) Alexandre Svietchine était d’ailleurs un disciple de Clausewitz (il a rédigé sa biographie).
(21) A titre de modèles d’actions hostiles et destructrices qui ne sont pas rangée, d’ordinaire, dans les opérations militaires, mais qui pourraient rentrer dans le cadre d’une « guerre hors limites » : l’attaque contre internet du hacker Morris Jr et l’attaque financière de Georges Soros contre les marchés financiers du sud-est asiatique. En fait, la théorie de la « guerre hors limite » prévoit une combinaison de moyens militaires et/ou non-militaires correspondant à chaque besoin spécifique.
(22) La définition la guerre par l’usage de la force armée (ou, pour prendre la définition de Quiao Liang, Wang Xiangsui qui est à la limite de la dissolution du concept, par le fait de provoquer des destructions chez l’adversaire par des moyens qui ne sont pas forcément le combat armé) n’est pas réversible. Cf. la multiplication du nombre de ces « opérations [militaires] autre que la guerre » (interposition, maintien de la paix, etc.) qui focalisent l’attention des théoriciens de l’OTAN.
(23) Politique dans le sens le plus étroit policy (la gestion des affaires selon les intérêts d’un groupe socio-historique), parce que même alors, la guerre est une partie de la politique dans le sens politics, (l’ensemble des facteurs socio-historiques qui déterminent), et parce que la guerre est un instrument de la policy au sens le plus large. En effet, le vocable de « continuité » pourrait faire croire que la politique s’arrête où la guerre commence. On retrouve cette idée dans l’expression journalistique « solution politique » (comme si la solution militaire n’était pas politique, comme s’il n’y avait de politique que la diplomatie). Il est vrai que la guerre a sa propre logique (elle peut engendrer, par exemple, une « ascension aux extrêmes » qui dépasse l’intention initiale des décideurs politiques), mais elle appartient au domaine de la politique, dont elle est une expression, un prolongement, un instrument. Cf. La guerre, instrument ou expression de la politique. Remarques à propos de Clausewitz , par Günter Maschke, dans la revue Stratégique n°77-78. Texte intégral sur www.stratisc.org.
Cliquez pour accéder au document La Décision

Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs ;
La terre n’appartient qu’aux hommes,
L’oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent !
Mais, si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins, disparaissent,
Le soleil brillera toujours !

C’est la lutte finale :
Groupons-nous, et demain,
L’internationale
Sera le genre humain.
(suite et fin dans le numéro 09 de Clarté)