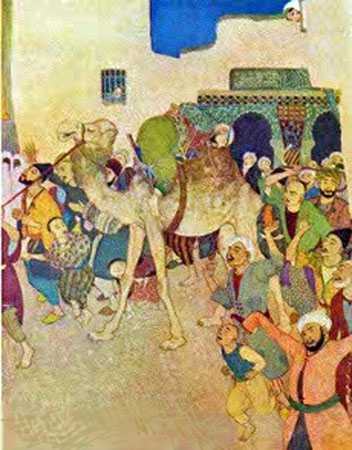 Lorsque le christianisme s’est développé, et a jeté le continent européen dans le terrible et sombre Moyen-Âge, les penseurs se situant dans le prolongement de l’Antiquité gréco-romaine durent se réfugier en Orient.
Lorsque le christianisme s’est développé, et a jeté le continent européen dans le terrible et sombre Moyen-Âge, les penseurs se situant dans le prolongement de l’Antiquité gréco-romaine durent se réfugier en Orient.
Leur pensée et leurs savoirs auraient alors pu disparaître, si ce n’est qu’une civilisation était alors en plein essor dans cette partie du monde, et avait soif de culture afin tant de se développer que d’asseoir son idéologie.
Cette civilisation, c’est la civilisation arabe ; cette culture, c’est la culture islamique. L’islam est né en tant qu’idéologie de cette civilisation, tout comme le christianisme est né comme idéologie de différentes sociétés, dans un cadre précis.
Et de la même manière que le christianisme n’était qu’une religion parmi une multitude d’autres, l’Islam n’était qu’une religion parmi une multitude d’autres. Ce n’est qu’au bout d’une longue synthèse, conditionnée par les rapports sociaux, que ces religions se développeront pour atteindre leur pleine maturité, sous différentes formes selon les cadres nationaux.
Nous allons ici étudier le cadre de ce développement, en accordant une attention particulière à l’Islam des philosophes, l’Islam des « falasifa » (pluriel de « faylasoof »). La philosophie, la « falsafa » en arabe, est un mode de pensée tendant au matérialisme et ayant contribué de manière essentielle à l’humanisme tel qu’il se développera en Europe.
Sans falsafa arabo-persane, pas d’humanisme européen.
Nous étudierons ainsi dans une première partie la période initiale de l’Islam, celle marquée par l’essor de la civilisation arabe et justement l’intégration des connaissances gréco-romaines, principalement grecques.
Dans une seconde partie, nous accorderons notre attention au poète Al Ma’ari, dont la pensée profonde témoigne justement d’un regard critique sur la société de son temps, allié à une vision philosophique du monde extrêmement avancée et authentiquement humaniste.
Dans une troisième partie, nous regarderons comment est née la falsafa, dans ses modalités pratiques, par l’intermédiaire des activités d’Al-Kindi et d’Al-Farabi.
Dans une quatrième partie, nous étudierons en détail les systèmes philosophiques les plus développés de la falsafa : l’avicénnisme (d’Avicenne, ibn Sīnā) et l’avérroïsme (d’Averroès, Ibn Rushd), qui joueront un rôle déterminant pour l’humanisme en Europe.
Dans une cinquième partie, nous regarderons comment la réaction islamique, conduite par Ghazali, a triomphé de la falsafa, par l’intermédiaire de la mystique soufi.
Dans une sixième partie, nous verrons que la falsafa a pu se prolonger culturellement dans l’Inde des Moghols, dont la figure historique la plus significative et importante est Jalâluddin Muhammad Akbar.
Dans une septième partie, nous comprendrons enfin comment l’Islam a profité historiquement de la falsafa, notamment pour ce qui concerne « l’apparence » philosophique, et pourquoi son contenu actuel est lié à la pénétration impérialiste en Asie et en Afrique et a été théorisé aux 19ème et 20ème siècles.
L’essor de la civilisation arabe n’est, en soi, pas un phénomène original. Friedrich Engels a parfaitement constaté que les empires assyriens et babyloniens étaient déjà issus de guerre de conquêtes. De la même manière, de grandes villes avaient déjà pu être fondées de manière très rapides, comme Ninive et Babylone alors, ou Agra, Delhi, Lahore en Inde lors de la conquête musulmane.
L’essor de la civilisation arabe n’est pas, non plus, quelque chose d’incompréhensible quand on regarde la configuration de l’époque. Les tribus arabes étaient en effet présentes sur 3 millions de km² ; un vaste système commercial reliait le sud (la péninsule arabe) au nord (la Méditerranée et le golfe arabo-persique, soit le sud de la Mésopotamie).
Les tribus arabes étaient, dans le nord, subordonnées aux empires perse et byzantin ; dans le sud, le déclin commercial est parallèle à l’effondrement de l’Empire romain. La culture patriarcale épuisait les tribus dans des querelles incessantes.
L’Islam, proposé par Mahomet au 7ème siècle, apparaît alors comme un drapeau afin d’unifier les tribus arabes et débloquer la situation locale, au moyen d’une guerre de conquête. La religion musulmane apparaît clairement à sa naissance comme un outil pour forger l’unité nationale.
L’Islam n’est pas une proposition d’identité universelle future, mais un rappel à une identité idéale et fictive dans le passé. Friedrich Engels constate ainsi (dans une lettre à Karl Marx du 24 mai 1853) :
« En ce qui concerne les supercheries religieuses, il semble ressortir des inscriptions anciennes trouvées dans le Sud où prédomine encore la vieille tradition nationale arabe du monothéisme (comme chez les Indiens d’Amérique) – et dont la tradition hébraïque ne constitue qu’une petite partie – que la révolution religieuse de Mahomet, comme tout mouvement religieux, a été dans sa forme une réaction, un prétendu retour aux anciennes coutumes, à la simplicité. »
De fait, si l’on suit le Coran, l’Islam est une religion « naturelle », le monothéisme est « naturel » (c’est la hanifiyya ; le Coran dit ainsi – 3/67 – :
« Abraham n’était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu (Musulman) »).
La conquête de la Mecque était un objectif national, puisqu’il s’agissait d’un centre religieux de grande importance, tant par l’ampleur des cultes (presque 300 idoles, dieux et saints) que par la présence de la Kaaba (le « cube », petit bâtiment où est « vénérée » une roche noire).
Le culte de la Kaaba a été intégré à l’Islam, tout comme le « ta’r » (le principe de la vendetta) a été intégré dans les principes juridiques.
Il y a donc adaptation des cultes et des pensées locales, dans une grande synthèse, qui a d’ailleurs mis vingt ans à être construite, et dont la version finale en tant que Coran ne sera mise par écrit qu’après la mort de Mahomet.
Mahomet lui-même a pu « changer d’avis » en cours de rédaction, ce qui est au moins attesté par un épisode contradictoire connu. Des versets célébraient des divinités protectrices, puis Mahomet s’est rétracté expliquant que ces versets auraient en réalité été insufflé par Satan pour le tromper (ce sont les « versets sataniques »).
Et dès la mort de Mahomet, de multiples factions se heurteront lors de sanglants conflits, pour des raisons tribales, sociales et nationales : jamais l’Islam n’obtiendra de réelle unité.
Mais l’Islam a permis, tout comme le christianisme, de faire sortir les tribus arabes de l’ornière des rapports patriarcaux les plus élémentaires.
Pour autant, de par sa base, l’Islam était condamné dès le départ. L’Islam est né comme idéologie d’unification nationale, mais la base de la nation ne peut reposer historiquement que sur la bourgeoisie.

Or, la réalité des rapports sociaux ne pouvait permettre l’émergence de celle-ci que de manière relative, en raison de l’absence d’une agriculture solidement établie, formant un arrière-pays aux villes.
Friedrich Engels, dans une lettre à Karl Marx (du 6 juin 1853), constate ainsi :
L’absence de propriété foncière est en effet la clé de toute l’Orient. C’est la base de l’histoire politique et religieuse.
Mais quelle est l’origine du fait que les Orientaux ne parviennent pas à la propriété foncière, même pas de type féodal ?
Je crois que cela dépend essentiellement du climat, lié aux conditions de sol, en particulier aux grandes zones désertiques qui s’étendent du Sahara, à travers l’Arabie, la Perse et la Tatarie jusqu’aux plus hauts plateaux de l’Asie.
L’irrigation artificielle est ici la condition première de l’agriculture : or, elle est l’affaire soit des communes, des provinces, ou du gouvernement central. Le gouvernement, en Orient, n’a jamais eu que trois départements : finances (mise au pillage du pays), guerre (pillage du pays et des pays voisins) et travaux publics.
En lançant une guerre de conquête, les tribus arabes ont réussi à dépasser des clivages tribaux ; l’Islam a ici joué un rôle progressiste, en établissant une civilisation nouvelle.
Mais les rapports inévitablement conflictuels avec les autres nations (notamment la Perse, qui adaptera l’Islam à « sa » manière) et principalement l’absence de propriété foncière ont condamné la guerre de conquête à voir le sol se dérober sous ses pieds à la moindre pause (et celle-ci peut s’avérer très tardive, comme en Inde, où l’on assiste exactement au même phénomène).
Sans propriété foncière, il n’y a pas de féodalité, pas de naissances de villes établissant une accumulation du capital autonome, pas d’évolution technique ni des rapports de production.
Karl Marx constate :
Plus la production marchande se développe et s’étend, moins la fonction de la monnaie comme moyen de paiement est restreinte à la sphère de la circulation des produits. La monnaie devient la marchandise générale des contrats.
Les rentes, les impôts, etc., payés jusque-là en nature, se payent désormais en argent. Un fait qui démontre, entre autres, combien ce changement dépend des conditions générales de la production, c’est que l’Empire romain échoua par deux fois dans sa tentative de lever toutes les contributions en argent.
La misère énorme de la population agricole en France sous Louis XIV, dénoncée avec tant d’éloquence par Boisguillebert, le maréchal Vauban, etc., ne provenait pas seulement de l’élevation de l’impôt, mais aussi de la substitution de sa forme monétaire à sa forme naturelle.
En Asie, la rente foncière constitue l’élément principal des impôts et se paie en nature. Cette forme de la rente, qui repose là sur des rapports de production stationnaires, entretient par contrecoup l’ancien mode de production. C’est un des secrets de la conservation de l’Empire turc. (Le Capital, I, 3).
L’empire turc, ou plus exactement l’empire ottoman, dominait précisément les zones arabes, dans une période s’étalant du 13ème au 19ème siècle. Tout comme la conquête arabe, cet empire s’écroulera, victime de ses « rapports de production stationnaires. »