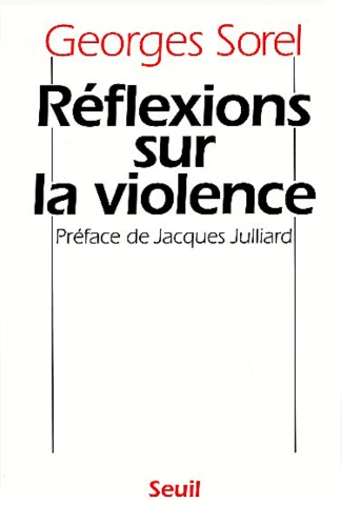 Les Réflexions sur la violence de Georges Sorel forment une œuvre extrêmement célèbre dans l’histoire des idées. Celle-ci n’est pourtant pas devenue l’origine d’un mouvement politique ou social ; on peut même dire que, de par son contenu éclectique, entre digressions historiques et remarques intellectuelles, l’oeuvre est d’une profonde incohérence.
Les Réflexions sur la violence de Georges Sorel forment une œuvre extrêmement célèbre dans l’histoire des idées. Celle-ci n’est pourtant pas devenue l’origine d’un mouvement politique ou social ; on peut même dire que, de par son contenu éclectique, entre digressions historiques et remarques intellectuelles, l’oeuvre est d’une profonde incohérence.
Par ailleurs, il est connu que les multiples textes de Georges Sorel se caractérisent justement par le fait de partir dans tous les sens, d’effectuer des remarques sans former un tout cohérent, unifié.
Mais c’est paradoxalement précisément cette dimension incohérente qui a fait le succès d’estime de Georges Sorel et des Réflexions sur la violence. Sa démarche répondait à une besoin très particulier, une approche sociale et culturelle bien déterminée.
Quel était ce besoin, d’où venait-il ?
Il faut saisir le contexte, qui est celui de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. A l’Est de l’Europe, il existe une forte social-démocratie, qui vise la révolution et se revendique du marxisme le plus orthodoxe.
Son théoricien est Karl Kautsky et déjà des personnalités se profilent comme l’aile gauche de la social-démocratie : la polonaise Rosa Luxembourg, également active en Allemagne, et le russe Lénine.
En France, la social-démocratie est tout à fait différente. Union des courants socialistes, elle ne connaît pratiquement rien au marxisme, et ce qu’elle connaît, elle le connaît mal, s’imaginant que la dialectique signifie unifier les contraires. Son principal dirigeant, Jean Jaurès, est de toutes façons un républicain de gauche, pour qui le socialisme n’est somme toute qu’une République bien faite.
Or, le drame est que cette social-démocratie non-marxiste apparaît aux yeux des masses comme la représentante du marxisme, dans la mesure où elle profite de l’aura de la formidablement puissante social-démocratie allemande.
Pour cette raison, le marxisme apparaît comme un moyen pour des hommes politiques de s’appuyer sur les ouvriers et leurs luttes pour s’insérer dans l’administration, au gouvernement, etc.
Cela provoquera une réaction de dégoût s’exprimant par un rejet fondamental de la politique, d’abord par les « bombistes », les anarchistes jetant des bombes, dont la figure la plus connue est Ravachol, puis par la suite par le syndicalisme révolutionnaire.
A l’opposé de l’Est de l’Europe où les dérives réformistes d’une social-démocratie, bien différente par ailleurs, sont critiquées politiquement, par la gauche, ce qui donnera le mouvement communiste (avec les bolcheviks et les spartakistes), en France la critique est de droite, d’obédience anarchiste.
C’est là qu’intervient Georges Sorel. Celui-ci n’est pas au sens strict le théoricien du syndicalisme révolutionnaire : il ne l’a pas inventé, il ne l’a pas formulé. Il n’est en fait même pas un théoricien du syndicalisme révolutionnaire, courant qu’il soutient, mais dont il reste finalement extérieur.
Ce que fait Georges Sorel, c’est justement reprendre la critique syndicaliste-révolutionnaire de la social-démocratie, en proposant un nouveau modèle de révolution.
C’est une révolution qui serait anti-politique et proposerait une nouvelle civilisation, à travers un moyen essentiel car permettant de tout renouveler : la violence.
La classe ouvrière n’est pas ici le fruit d’une dialectique historique au sein d’un mode de production en crise, mais l’outil pour un projet de société utilisant la violence comme vecteur pour bouleverser l’ordre social.
Il ne manquait qu’un pas pour que, une fois la classe ouvrière mise de côté, on ait l’idée d’un projet révolutionnaire de régénération, qui sera justement la thèse de la révolution fasciste.
Georges Sorel ne fera pas ce pas. Si le Cercle Proudhon organisé dans la mouvance de l’Action française se revendique de lui, Georges Sorel restera cependant distant, conservant une option non nationaliste et opposé à l’armée, comme en témoigne son opposition à a première guerre mondiale.
Cependant, son parcours reste en même temps empreint d’antisémitisme et de fréquentation de syndicalistes révolutionnaires basculant dans le nationalisme. S’il saluera Lénine, en qui il voit celui qui porte un « coup de force » comme justement il l’apprécie, ce sera Benito Mussolini qui s’en revendiquera.
En ce sens, Georges Sorel reste un auteur marginal ; il n’a été qu’un outil historique de l’affirmation de la « révolution fasciste » comme thèse politique. Mais il exprime également un véritable travers français, mêlant incompréhension du marxisme, l’éloge de la spontanéité et du coup de force par le mépris de l’intellect, la fascination pour l’union des contraires.
En ce sens, ces erreurs françaises ont contribué de manière essentielle à la genèse de l’idéologie de la contestation anti-parlementaire d’une classe dominante réduite à la ploutocratie, du culte de l’irrationalisme et de la fascination pour la violence, pour le coup d’éclat, le coup d’État.