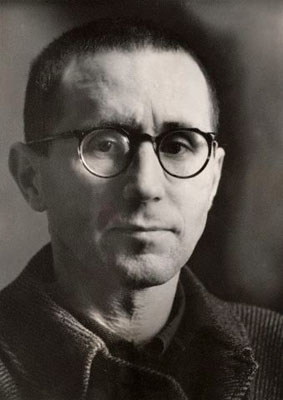 Camarades, sans prétendre apporter beaucoup de nouveauté, j’aimerais dire quelque chose sur la lutte contre ces forces qui s’apprêtent, aujourd’hui, à étouffer la culture dans le sang et l’ordure, ou plutôt les restes de culture qu’a laissé subsister un siècle d’exploitation.
Camarades, sans prétendre apporter beaucoup de nouveauté, j’aimerais dire quelque chose sur la lutte contre ces forces qui s’apprêtent, aujourd’hui, à étouffer la culture dans le sang et l’ordure, ou plutôt les restes de culture qu’a laissé subsister un siècle d’exploitation.
Je voudrais attirer votre attention sur un seul point, sur lequel la clarté devrait, à mon avis, être faite, si vraiment l’on veut mener contre ces puissances une lutte efficace, et surtout si l’on veut la mener jusqu’à sa conclusion finale.
Les écrivains qui éprouvent les horreurs du fascisme, dans leur chair ou dans celle des autres, et en demeurent épouvantés, ne sont pas pour autant, avec cette expérience vécue ou cette épouvante, en état de combattre ces horreurs.
Beaucoup peuvent croire qu’il suffit de les décrire, surtout lorsqu’un grand talent littéraire et une sincère indignation rendent la description prenante.
De fait, ces descriptions sont d’une grande importance.
Voilà qu’on commet des horreurs.
Cela ne doit pas être.

Voilà qu’on bat des êtres humains.
Il ne faut pas que cela soit.
À quoi bon de longs commentaires ?
Les gens bondiront, et ils arrêteront le bras des bourreaux.
Camarades, il faut des commentaires.
Les gens bondiront, peut-être, c’est relativement facile.
Mais pour ce qui est d’arrêter le bras des bourreaux, c’est déjà plus difficile.
L’indignation existe, l’adversaire est désigné.
Mais comment le vaincre ?
L’écrivain peut dire : ma tâche est de dénoncer l’injustice, et il abandonne au lecteur le soin d’en finir avec elle.
Mais alors, l’écrivain va faire une expérience singulière.
Il va s’apercevoir que la colère comme la pitié sont des phénomènes de masse, des sentiments qui quittent les foules comme ils y sont entrés.
Et le pire est qu’ils les quittent d’autant plus qu’ils deviennent plus nécessaires.
Des camarades me disaient : la première fois que nous avons annoncé que des amis étaient massacrés, il y a eu un cri d’horreur, et l’aide est venue, en quantité.
Puis on en a massacré cent. Et lorsqu’on en eut tué mille et que le massacre ne sembla plus devoir finir, le silence recouvrit tout, et l’aide se fit rare.
C’est ainsi : « Lorsque les crimes s’accumulent, ils passent inaperçus. Lorsque les souffrances deviennent intolérables, on n’entend plus les cris. Un homme est frappé à mort, et celui qui assiste est frappé d’impuissance.
Rien là que de normal.
Lorsque les forfaits s’abattent comme la pluie, il n’y a plus personne pour crier qu’on les arrête. »
Voilà ce qu’il en est.

Comment y parer ? N’y a-t-il donc aucun moyen d’empêcher les hommes de se détourner de l’horreur ? Pourquoi s’en détournent-ils ?
Parce qu’ils ne voient pas la possibilité d’intervenir.
S’il n’a pas la possibilité de les aider, l’homme ne s’attarde pas sur la douleur des autres. On peut retenir le coup lorsqu’on sait où, quand, pour quelle raison, dans quel but il est donné.
Et lorsqu’on peut arrêter le coup, lorsqu’il subsiste pour cela une possibilité, fût-ce la plus mince, alors on peut avoir pitié de la victime.
On le peut aussi dans le cas contraire, mais pas longtemps, en tout cas pas au-delà du moment où les coups commencent à s’abattre sur la victime comme la grêle.
Alors, pourquoi les coups tombent-ils ? Pourquoi la culture, ou ces restes de culture qu’on nous a laissés, pourquoi est-ce jeté par-dessus bord comme un poids mort et encombrant ?
Pourquoi la vie de millions d’hommes, de la grande majorité des hommes, est-elle à ce point appauvrie, dénudée, à moitié ou complètement détruite ?
Il y en a parmi nous qui ont une réponse.
Ils disent : c’est la sauvagerie.
Ils croient assister chez une part, et une part de plus en plus grande, de l’humanité, à un déchaînement effrayant, un déchaînement soudain, sans cause décelable, et qui disparaîtra peut-être, du moins ils l’espèrent, aussi vite qu’il est survenu ; à l’irrésistible remontée au grand jour d’une barbarie longtemps réprimée ou en sommeil, et de nature instinctuelle.
Ceux qui répondent de la sorte sentent évidemment eux-mêmes qu’une telle réponse ne porte pas très loin.
Et ils sentent également eux-mêmes qu’il n’est pas juste d’attribuer à la sauvagerie l’apparence d’une force naturelle, d’une invincible puissance infernale.
Aussi disent-ils qu’on a négligé l’éducation du genre humain.
Il y a un devoir dans ce domaine auquel on a manqué, ou bien c’est le temps qui a manqué. Il faut rattraper cela, réparer cette négligence, et mobiliser contre la barbarie – la bonté.
Il faut faire appel aux grands mots, conjurer les grandes et impérissables idées qui nous ont déjà sauvés une fois : liberté, dignité, justice, dont l’histoire passée est là pour garantir l’efficacité.
Et les voilà tout à leurs grandes incantations.
Que se passe-t-il alors ? Lui fait-on reproche d’être sauvage, le fascisme répond par un éloge fanatique de la sauvagerie.

Accusé d’être fanatique, il répond par l’apologie du fanatisme.
Le convainc-t-on de violation, de destruction de la raison, il franchit le pas allègrement, et il condamne la raison.
C’est que le fascisme trouve, lui aussi, qu’on a négligé l’éducation des masses. Il attend beaucoup de la suggestion des esprits et de l’endurcissement des cœurs.
À la barbarie de ses chambres de torture, il ajoute celle de ses écoles, de ses journaux, de ses théâtres.
Il éduque l’ensemble de la nation, il ne fait même que cela du matin au soir. Il n’a pas grand-chose d’autre à distribuer aux masses : d’où un gros travail d’éducation.
Comme il ne donne pas aux gens de quoi manger, il leur apprend comment se discipliner.
Il n’arrive pas à mettre de l’ordre dans son système de production, il lui faut pour cela des guerres, il développera donc l’éducation et le courage physiques.
Il lui faut sacrifier des victimes, il développera donc le sens du sacrifice.
Cela aussi, c’est exiger beaucoup des hommes, cela aussi, ce sont bel et bien des idéaux, parfois même des exigences très hautes, des idéaux élevés.
Seulement, nous savons à quoi servent ces idéaux, qui est ici l’éducateur, et au service de qui cette éducation est mise : sûrement pas au service des éduqués.
Qu’en est-il de nos idéaux à nous ?
Même ceux d’entre nous qui aperçoivent dans la barbarie la racine du mal ne parlent, on l’a vu, que d’éduquer, d’influencer les esprits – sans rien influencer d’autre.
Ils parlent d’apprendre aux gens la bonté. Mais on n’arrivera pas à la bonté par l’exigence de bonté, de bonté sous n’importe quelles conditions, même les pires ; pas plus que la barbarie ne résulte de la barbarie.
Pour ma part, je ne crois pas à la barbarie pour la barbarie. Il faut défendre l’humanité quand on prétend qu’elle serait barbare même si la barbarie n’était pas une bonne affaire.

Mon ami Feutchwanger parodie avec esprit les Nazis lorsqu’il dit : la bassesse générale prime l’intérêt particulier 1 ; mais il n’a pas raison. La barbarie ne provient pas de la barbarie, mais des affaires ; elle apparaît lorsque les gens d’affaires ne peuvent plus faire d’affaires sans elle.
Dans le petit pays d’où je viens 2, le régime est moins terrible que dans bien d’autres. Et pourtant, chaque semaine, on y détruit cinq mille têtes du meilleur bétail. C’est un malheur, mais ce n’est pas le déchaînement subit d’instincts sanguinaires.
S’il en était ainsi, ce serait moins grave. La cause commune à la destruction du bétail et à la destruction des biens culturels, ce ne sont pas des instincts barbares. Dans un cas comme dans l’autre, on détruit une partie de ces biens qui ont coûté beaucoup de peines, parce qu’elle est devenue une gêne et une charge.
Quand on sait que les cinq continents souffrent de la faim, ces mesures sont à n’en pas douter des crimes, mais ils n’ont rien, absolument rien d’actes gratuits commis par malignité pure.
Dans le régime social en vigueur actuellement dans la plupart des pays du globe, les crimes en tous genres sont largement récompensés et les vertus coûtent très cher.
« L’homme bon est sans défense et l’homme sans défense se fait matraquer : mais avec de la bassesse on obtient tout.
La bassesse s’installe pour dix mille ans.
La bonté, elle, a besoin de gardes du corps, et elle n’en trouve pas. »
Gardons-nous d’exiger des hommes la bonté, sans autre précision !
Puissions-nous, nous aussi, ne rien demander d’impossible !
Ne nous exposons pas, nous aussi, au reproche d’exhorter l’homme à des performances surhumaines, comme de supporter un régime effroyable grâce à de hautes vertus, un régime dont on dit qu’il pourrait sans doute être changé, mais non pas qu’il doit l’être ! Ne défendons pas que la culture !
Ayons pitié de la culture, mais ayons d’abord pitié des hommes !
La culture sera sauvée quand les hommes seront sauvés.
Ne nous laissons pas entraîner à dire que les hommes sont faits pour la culture et non la culture pour les hommes ! Cela rappellerait trop la pratique des foires où les hommes sont là pour les bêtes de boucherie, et non l’inverse !
Camarades, réfléchissons aux racines du mal !
Voici qu’une grande doctrine, qui s’empare de masses de plus en plus grandes sur notre planète (laquelle est encore très jeune), dit que la racine de tous nos maux est dans les rapports de propriété.
Cette doctrine, simple comme toutes les grandes doctrines, s’est emparée des masses qui ont le plus à souffrir des rapports de propriété existants et des méthodes barbares par lesquelles ils sont défendus.
Elle devient réalité dans un pays qui couvre le sixième du globe, où les opprimés et les non-propriétaires ont pris le pouvoir.

Là-bas on ne détruit pas les denrées alimentaires, on ne détruit pas les biens culturels.
Beaucoup d’entre nous, écrivains, qui apprenons et réprouvons les horreurs du fascisme, n’ont pas encore compris cette doctrine et n’ont pas décelé les racines de la barbarie.
Ils courent toujours, comme avant, le danger de considérer les cruautés du fascisme comme des cruautés gratuites.
Ils demeurent attachés aux rapports de propriété parce qu’ils croient que les cruautés du fascisme ne sont pas nécessaires pour les défendre.
Mais ces cruautés sont nécessaires à la préservation des rapports de propriété existants.
En cela les fascistes ne mentent pas, ils disent la vérité.
Ceux d’entre nos amis que les cruautés du fascisme indignent autant que nous, mais qui tiennent aux rapports de propriété existants, ou que la question de leur maintien ou de leur renversement laisse indifférents, ne peuvent mener le combat contre une barbarie qui submerge tout avec suffisamment d’énergie et de persévérance, parce qu’ils ne peuvent nommer, et aider à instaurer, les rapports sociaux qui devraient rendre la barbarie superflue.
Par contre, ceux qui, à la recherche des sources de nos maux, sont tombés sur les rapports de propriété, ont plongé toujours plus bas, à travers un enfer d’atrocités de plus en plus profondément enracinées, pour en arriver au point d’ancrage qui a permis à une petite minorité d’hommes d’assurer son impitoyable domination.
Ce point d’ancrage, c’est la propriété individuelle, qui sert à exploiter d’autres hommes, et que l’on défend du bec et des dents, en sacrifiant une culture qui ne se prête plus à cette défense ou refuse désormais de s’y prêter, en sacrifiant les lois de toute société humaine, pour lesquelles l’humanité a combattu si longtemps et avec l’énergie du désespoir.
Camarades, parlons des rapports de propriété !
Voilà ce que je voulais dire au sujet de la lutte contre la barbarie montante, afin que cela fût dit ici aussi, ou que moi aussi je l’aie dit.