La situation du mouvement ouvrier en France à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle se caractérise par un énorme retard idéologique et culturel en comparaison avec les classes ouvrières d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie.
Dans ces deux derniers pays, la social-démocratie est fermement ancrée sur le terrain du marxisme ; elle possède de solides traditions, elle a réussi à former de nombreux cadres, et elle est capable de mener tant des discussions de haut niveau que des productions idéologiques et culturelles dans le prolongement du marxisme.
Il n’y a rien de cela en France, et c’était déjà vrai à l’époque de Karl Marx. Son ami Friedrich Engels raconte ainsi :
« Ce que l’on appelle ’marxisme’ en France est certes un article tout spécial, au point que Marx a dit à Lafargue : ’Ce qu’il y a de certain, c’est que moi je ne suis pas marxiste’ ».
(Friedrich Engels, Lettre à E. Bernstein du 2 novembre 1882)

Le problème fondamental est que du côté français, on considère que Karl Marx a apporté une méthode pour saisir l’économie, et rien de plus. Il y a une méconnaissance complète de la dialectique de la nature et une négation du caractère scientifique du marxisme.
En France, la social-démocratie se construit en dehors de la connaissance approfondie du marxisme, et qui est plus elle réduit le marxisme aux écrits de Karl Marx concernant l’économie et l’histoire.
C’est ici que Georges Sorel a joué un rôle essentiel, car c’est lui qui a massivement influencé et déformé la réception du marxisme en France, depuis l’extérieur de la social-démocratie.
La social-démocratie française se construit, en effet, notamment avec Jean Jaurès, sur la base du réformisme social. Elle n’apporte pas de vision du monde organisée à prétention scientifique, elle ne prétend pas organiser la révolution sociale de manière complète et absolue. Le marxisme apparaît dans ce cadre comme une « morale », un « appel », une « contribution » au mouvement socialiste, nullement comme une science.
Georges Sorel apparaît alors comme le « représentant » du marxisme, mais il prend en réalité le chemin inverse de celui de Lénine. Alors que ce dernier affirme qu’il faut suivre les enseignements de Friedrich Engels et que « la théorie de Marx est toute-puissante parce qu’elle est vraie », Sorel réfute totalement cela.
Georges Sorel affirmait par exemple :
« Ne conviendrait-il pas de supprimer cette expression : la dialectique, et tout ce qui se rapporte à la négation de la négation. »
Lettre à Benedetto Croce, 27 déc. 1897
Dans la même lettre, Georges Sorel expliquait :
« Il me paraît certain qu’Engels a plus d’une fois fait dévier l’interprétation vraiment scientifique de la pensée de Marx ; il me paraît que cela tient à ce qu’Engels n’avait qu’une préparation philosophique générale, celle de l’enseignement secondaire […]
Il a beaucoup contribué à lancer le matérialisme dans la voie de l’évolutionnisme et à en faire une dogmatique absolue fondée sur des constatations empiriques peu critiques : c’est ainsi qu’il a introduit la notion de facteur décisif […] qu’il a exposé l’histoire comme une évolution fatale, qu’il a brouillé les idées des socialistes avec ses hypothèses empruntées à Morgan, hypothèses qui n’ont aucun intérêt et qui sont en contradiction avec ce qu’on sait de plus exact sur les institutions primitives […]. Plus d’une fois il a été ainsi amené à formuler des paradoxes que les marxistes ont transformé en dogmes indiscutables. »
Georges Sorel refuse le marxisme en tant que science, et cela sera la conception dominante en France. A ses yeux :
« Faute d’avoir pu justifier sa supposition fondamentale, Marx ne peut passer sûrement de la théorie abstraite de la valeur et de la plus-value aux phénomènes : il peut seulement apporter des éclaircissements dans une certaine mesure mais d’une manière éloignée. On pourrait contester qu’il puisse jamais expliquer au sens scientifique du mot. »
Sur la théorie marxiste de la valeur, 1897
Le marxisme est ainsi un simple « outil », comme un autre. Pour Georges Sorel, l’idéologie ne synthétise pas le mouvement de la matière éternelle.
Comme il l’explique :
« Je ne suis pas de ceux qui pensent que les transformations du monde doivent être des applications de théories, fabriquées par des philosophes ; mais il me semble que si l’on réfléchit un peu sur l’histoire moderne on reconnaît facilement la vérité du principe suivant ; une révolution ne produit des changements profonds, durables et glorieux, que si elle est accompagnée d’une idéologie dont la valeur philosophique soit proportionnée à l’importance matérielle des bouleversements accomplis.
Cette idéologie donne aux acteurs du drame la confiance qui leur est nécessaire pour vaincre. Elle élève une barrière contre les tentatives de réaction que des juristes et des historiens préoccupés de restaurer les traditions rompues viendront préconiser ; enfin elle servira à justifier plus tard la révolution qui apparaîtra grâce à elle comme une victoire de la raison réalisée dans l’histoire.»
Mes raisons du syndicalisme, 1910
Georges Sorel ne révise cependant pas le marxisme, car il n’y a rien à réviser en France. Le marxisme est d’ailleurs pratiquement inconnu. Le livre I du Capital a d’abord été publié en 1872-1875, La guerre civile en France en 1872, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte en 1891, Critique de la philosophie du droit de Hegel ainsi que le Manifeste du parti communiste en 1895, la Contribution à la critique de l’économie politique et Salaires, prix, profits, en 1909.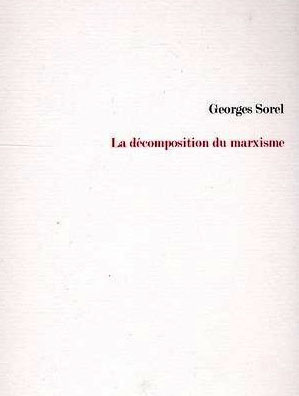
Du côté de Friedrich Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique a été publié en 1880, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État en 1893, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande et en appendice Notes de Karl Marx sur Feuerbach en 1901.
[A titre d’exemple, le projet de Grande Édition de Marx et d’Engels, devant publier tous les écrits de Karl Marx et Friedrich Engels, sous forme papier et électronique, a capoté en 2012, ne publiant en quatre ans que deux petits livres.]
Il n’y a ainsi pas de littérature fondée en tant que tel sur le marxisme. En France, il est pioché dans le marxisme, soit dans une version moraliste avec Jean Jaurès, soit dans un grand bricolage comme avec Georges Sorel.
Ce qui a fait en effet la gloire de Georges Sorel, c’est qu’il a essayé d’assumer le niveau théorique du marxisme, mais en développant sa propre théorie, fondée sur les mythes comme facteurs mobilisateurs. Et Georges Sorel a été le seul théoricien à affirmer que le marxisme était utile en tant que tel, à condition bien entendu de rentrer dans son propre système de pensée.
Georges Sorel commença ainsi dans le camp socialiste, se voulant un « adepte » du marxisme tel que lui-même l’avait compris, pour devenir ensuite le théoricien du refus de la politique au nom du « syndicalisme révolutionnaire », pour finir par appeler au combat contre la « démocratie » et la formation d’une « république aristocratique ».
Voici, par exemple, comment Georges Sorel interprète Karl Marx en l’intégrant à sa propre conception personnelle des mythes mobilisateurs :
« L’avant-dernier chapitre du premier volume du Capital ne peut laisser aucun doute sur la pensée intime de Marx : celui-ci représente la tendance générale du capitalisme au moyen de formules qui seraient, très souvent, fort contestables, si on les appliquait à la lettre aux phénomènes du temps et, à plus forte raison, aux phénomènes actuels ; on pourrait dire et on a dit que les espérances révolutionnaires du marxisme étaient vaines puisque les traits de ce tableau avaient perdu de leur réalité.
On a versé infiniment d’encre à propos de cette catastrophe finale qui devait éclater à la suite d’une révolte des travailleurs. Il ne faut pas prendre ce texte à la lettre ; nous sommes en présence de ce que j’ai appelé un mythe social ; nous avons une esquisse fortement colorée qui donne une idée très claire du changement, mais dont aucun détail ne saurait être discuté comme un fait historique prévisible. »
La Décomposition du marxisme, 1907
Georges Sorel ne croit pas au caractère scientifique du marxisme, selon lui
« on doit repousser énergiquement des études historiques la terminologie marxiste de la nécessité »
Préface à Edwin Seligman, L’interprétation économique de l’histoire, 1911
Cette conception anti-scientifique a comme conséquence que le marxisme doit être considéré comme erroné. Aussi considère-t-il que le marxisme a échoué dans son affirmation de l’imminence de la révolution, alors que le marxisme n’a jamais prétendu cela. Georges Sorel n’est pas un « déçu », c’est un théoricien bourgeois rejetant le marxisme et prétendant que celui-ci est un échec.
Voici comment il présente cela :
« Comme il (Marx) croyait la révolution imminente, il n’a pas mis ses disciples en garde contre la contingence des bases historiques du mécanisme étudié par lui. La révolution n’a pas eu lieu, ce qui montre qu’il s’était trompé sur l’appréciation des forces, mais cette erreur de fait ne saurait suffire pour le faire ranger parmi les utopistes. »
Y a-t-il de l’utopie dans le marxisme ?
Georges Sorel n’est pas d’accord avec la conception selon laquelle l’être humain est le reflet de son milieu ; dans sa conception, la religion et la morale sont indépendants de la base sociale. C’est tout le principe de l’idéologie comme reflet que rejette Georges Sorel.
C’est pour cette raison que Sorel annonce la « crise du socialisme scientifique » et appelle à quitter le terrain du « marxisme orthodoxe » – qu’il n’a jamais assumé en fait – pour « retourner à Marx » (La crisi del socialismo scientifico, Critica sociale, VIII, 9, mai 1898).
C’est pour cela également que Georges Sorel soutient Alfred Dreyfus, mais qu’il est immédiatement déçu par la suite. Il pensait que le mouvement moral l’emporterait et basculerait dans le socialisme, le mouvement ouvrier se soulevant au moyen des syndicats, qui sont pour Georges Sorel la forme la plus « pure ».
Or, la victoire des dreyfusards ne fait que renforcer la république bourgeoise. Voici la réaction de Georges Sorel :
« La liquidation de la révolution dreyfusienne devait me conduire à reconnaître que le socialisme prolétarien ou syndicalisme ne réalise pleinement sa nature que s’il est volontairement un mouvement ouvrier dirigé contre les démagogues.
A la différence du socialisme politique, il n’emprunte point d’éléments spirituels à la littérature démocratique ; […] le socialisme prolétarien s’oppose donc à la démocratie, au moins en tant que celle-ci favorise le progrès de son contraire, le socialisme politique. »
La révolution dreyfusienne, 1909
Georges Sorel « invente » donc le principe du socialisme « prolétarien » – c’est-à-dire en fait le « syndicalisme révolutionnaire » – en opposition au socialisme « politique », c’est-à-dire le marxisme, même si c’est en fait le marxisme édulcoré et de façade, largement marqué par le libéralisme, de la social-démocratie de Jean Jaurès.
Georges Sorel va par conséquent rejeter la démocratie comme étant décadente et chercher à élaborer la construction d’une véritable aristocratie, rejetant tous les opportunistes politiques. Il explique de la manière suivante comment la démocratie républicaine bourgeoise l’aurait trompé :
« Je confondais ici l’utopie philosophique de la démocratie, qui a enivré l’âme de nos pères, avec la réalité du régime démocratique, qui est un gouvernement de démagogues ; ceux-ci ont intérêt à célébrer l’utopie, afin de dissimuler aux yeux du peuple la véritable nature de leur activité.»
Mes raisons du syndicalisme, 1910
Georges Sorel théorise par conséquent le refus complet de la « politique », qui serait forcément corrompue, manipulatrice. Il en fait toute une vision du monde :
« La véritable vocation des Intellectuels est l’exploitation de la politique ; le rôle de politicien est fort analogue à celui de courtisan, et il ne demande pas d’aptitude industrielle. Il ne faut pas leur parler de supprimer les formes traditionnelles de l’Etat ; c’est en quoi leur idéal, si révolutionnaire qu’il puisse paraître aux bonnes gens, est réactionnaire. Ils veulent persuader aux ouvriers que leur intérêt est de les porter au pouvoir et d’accepter la hiérarchie des capacités qui met les travailleurs sous la direction des hommes politiques.»
Matériaux d’une théorie du prolétariat
La réponse que trouve Georges Sorel se situe dans les syndicats qui seraient les véritables représentants du mouvement ouvrier, qui seraient incorruptibles à condition de refuser la politique et la démocratie. Il affirme ainsi :
« En France, ils [les intellectuels] prétendent que leur vraie place est dans le Parlement et que le pouvoir dictatorial leur reviendrait de plein droit en cas de succès. C’est contre cette dictature représentative du prolétariat que protestent les syndicaux.»
L’avenir socialiste des syndicats
Georges Sorel rejoint ainsi directement les thèses de Pierre-Joseph Proudhon, qu’en 1914 il considère comme « le plus grand philosophe du XIXe siècle ». Et de la même manière que Pierre-Joseph Proudhon, il accorde finalement une grande valeur au christianisme, comme obstacle à la décadence amenée par la démocratie.
Georges Sorel rejette le refus général de la propriété privée, il considère que la lutte des classes – la seule chose qu’il considère finalement comme valable dans le marxisme, ou plus exactement dans ce qu’il considère comme l’oeuvre de Karl Marx – procède à la régénération de la société.
Georges Sorel refuse tout système explicatif du monde. Il admet avec Blaise Pascal que toute considération est relative. Il utilise la pensée d’Henri Bergson pour expliquer que les processus de mobilisation sociale ne sont pas explicables, qu’on ne peut pas les anticiper.
Dans une réponse à l’enquête de la Grande revue au sujet de M. Henri Bergson et l’influence de sa pensée sur la sensibilité contemporaine, en 1914, Sorel n’hésite pas à affirmer :
« Je crois avoir de très bonnes raisons pour supposer que la gloire de M. Bergson est destinée à grandir. Son œuvre est liée étroitement à une révolution intellectuelle dont les effets s’étendent sans aucun doute sur de longues périodes.
Nous assistons à la décrépitude d’un rationalisme qui, depuis trois siècles, travaillait à ruiner les croyances chrétiennes ; Dieu avait été réduit à ne plus être qu’une machine métaphysique dont l’intervention échapperait à l’observateur du monde ; on conservait la théodicée dans les livres seulement à cause de l’ingéniosité de son argumentation.
Aujourd’hui les critiques adressées par les ’scientistes’ à la théologie mystique, à la doctrine des sacrements, à la morale de l’ascétisme paraissent superficielles à ceux des psychologues qui se sont nourris des thèses de William James ; la possibilité du miracle, que Renan regardait comme définitivement écartée par la science, est admise sans difficulté par les savants qui ont le plus réfléchi sur les conditions du déterminisme ; on peut donc dire que l’esprit de Pascal l’emporte, de jour en jour davantage, sur l’esprit de Descartes.
J’avais émis, il y a une dizaine d’années, l’opinion que les catholiques ne [tarderaient] probablement pas à introduire dans leur métaphysique certaines idées bergsoniennes ; mes prévisions ne se sont pas réalisées, parce que, des ’modernistes’ ayant invoqué dans leurs polémiques l’autorité de M. Bergson, Rome en est venue à beaucoup se défier des écrits de l’illustre professeur ; mais il ne faut pas oublier que tout récemment des adversaires avisés de l’Église ont signalé les dangers que fait courir à leur cause l’enseignement donné par M. Bergson au Collège de France. »
Écho sioniste, 10 mai 1912
« Je suis toujours persuadé que la nouvelle philosophie est très favorable aux principes essentiels du christianisme. On pourrait définir assez bien, je crois, de la façon suivante, le rôle que l’histoire attribuera très vraisemblablement à M. Bergson : le succès de ses livres tient surtout à ce qu’il existe des orientations ’pascaliennes’ dans l’élite de la société contemporaine ; d’autre part la vulgarisation de ses doctrines multiplie [ces] 11 orientations, les précise et en accroît l’efficacité ; ainsi, grâce en partie à M. Bergson, Pascal tend à devenir le grand directeur du siècle.
Si ce jugement est exact, on doit présumer que les profondeurs de l’âme moderne subiront l’influence de M. Bergson bien plus fortement qu’elles n’ont subi des influences de Taine ou de Nietzsche.»
Georges Sorel, luttant pour la révolution, doit alors trouver un moyen de mobiliser pour celle-ci, et c’est pour cela qu’il théorise le « mythe ». Il donne son point de vue dans La décomposition du marxisme (1908) :
« Marx croyait que le régime démocratique offre cet avantage que l’attention des ouvriers n’étant plus attirée par des luttes contre la royauté ou l’aristocratie, la notion de lutte de classe devient alors beaucoup plus facile à entendre. L’expérience nous apprend, au contraire, que la démocratie peut travailler efficacement à empêcher le progrès du socialisme, en orientant la pensée ouvrière vers un trade-unionisme protégé par le gouvernement.
Depuis que nous avons sous les yeux les deux formes opposées de l’organisation syndicale, ce danger de la démocratie apparaît très clairement.
On est ainsi amené à regarder avec méfiance les révolutions politiques ; elles ne sont pas possibles sans que le parti qui triomphe ait derrière lui des masses ouvrières organisées ; une campagne menée en commun contre le pouvoir noue des relations qui peuvent préparer une évolution du syndicalisme vers le trade-unionisme protégé. Les catholiques font les plus grands efforts pour grouper les ouvriers dans des syndicats auxquels ils promettent monts et merveilles, dans l’espérance de faire peur aux politiciens radicaux et de sauver l’Église.
L’affaire Dreyfus peut être comparée fort bien à une révolution politique, et elle aurait eu pour résultat une complète déformation du socialisme, si l’entrée de beaucoup d’anarchistes dans les syndicats n’avait, à cette époque, orienté ceux-ci dans la voie du syndicalisme révolutionnaire et renforcé la notion de lutte de classe.
Il ne faut pas espérer que le mouvement révolutionnaire puisse jamais suivre une direction convenablement déterminée par avance, qu’il puisse être conduit suivant un plan savant comme la conquête d’un pays, qu’il puisse être étudié scientifiquement autrement que dans son présent. Tout en lui est imprévisible.
Aussi ne faut-il pas, comme ont fait tant de fois les anciens théoriciens du socialisme, s’insurger contre les faits qui semblent être de nature à éloigner le jour de la victoire.
Il faut s’attendre à rencontrer beaucoup de déviations qui sembleront remettre tout en question ; il y aura des temps où l’on croira perdre tout ce qui avait été regardé comme définitivement acquis ; le trade-unionisme pourra paraître triompher même à certains moments. C’est justement en raison de ce caractère du nouveau mouvement révolutionnaire qu’il faut se garder de donner des formules autres que des formules mythiques : le découragement pourrait résulter de la désillusion produite par la disproportion qui existe entre l’état réel et l’état attendu ; l’expérience nous montre que beaucoup d’excellents socialistes furent ainsi amenés à abandonner leur parti.»
Georges Sorel est donc quelqu’un qui a refusé le caractère scientifique du marxisme, marxisme qu’il ne connaissait que très partiellement et uniquement sous l’angle économique. Il a été un bourgeois, et par conséquent sa position reflète le caractère anti-scientifique de la bourgeoisie.
Refusant par contre la décadence de la bourgeoisie qu’il constate, il considère que le mouvement ouvrier peur régénérer la société, à la condition de ne pas faire de politique – c’est là qu’on voit la nature bourgeoise de Georges Sorel, qui refuse le droit à la classe ouvrière d’avoir son drapeau politique.
Il masque cela derrière une définition moraliste et idéaliste des classes sociales. Dans Matériaux d’une théorie du prolétariat (1918), il donne la définition suivante et erronée d’une classe sociale :
« Une classe pleinement développée est, d’après Marx, une collectivité de familles unies par des traditions, des intérêts, des vues politiques, et parvenues à un tel degré de solidarité qu’on puisse attribuer à l’ensemble une personnalité, le considérer comme un être qui raisonne et qui agit d’après ses raisons.»
Pour cette raison, dans la même perspective que Pierre-Joseph Proudhon, Georges Sorel lutte pour des « travailleurs libres » :
« L’éducation populaire, par exemple, semble être entièrement dirigée dans un esprit bourgeois ; tout l’effort historique du capitalisme a été de conduire les masses à se laisser gouverner par les conditions de l’économie capitaliste, en sorte que la société devînt un organisme ; tout l’effort révolutionnaire tend à créer des hommes libres ; mais les gouvernants démocratiques se donnent pour mission de réaliser l’unité morale de la France. Cette unité morale, c’est la discipline automatique des producteurs qui seraient heureux de travailler pour la gloire de leurs chefs intellectuels. »
Réflexions sur la violence
Le syndicalisme révolutionnaire est justement l’arme du renouvellement, car la démocratie a ruiné le socialisme. Georges Sorel explique :
« Il faut prendre son parti de l’avachissement général du socialisme, et chercher si nous ne nous sommes pas gravement trompés quand nous avons eu confiance dans le bon sens populaire. Nous avons trop suivi les conceptions de Rousseau. L’homme n’a aucune conscience naturelle du vrai, du juste, du beau… quand on va au fond de l’âme populaire, on trouve le servilisme royaliste, le ritualisme catholique et la niaiserie humanitaire qui ont été déposés par l’éducation qui ne peuvent disparaître que par un long travail et de critique et de renouvellement. »
Lettre à Lagardelle du 7 octobre 1906, publiée dans Educazione fascista, XI, 1933
Georges Sorel fait partie de ces bourgeois qui ont tenté de formuler une conception du monde pour contre l’émergence du matérialisme dialectique, il se rattache à un mouvement plus large, au sein de tout l’appareil d’Etat français, qui par les universités va lancer une grande opération idéologique : c’est la naissance, au 19ème siècle, de l’idéologie dominante propre à la France.