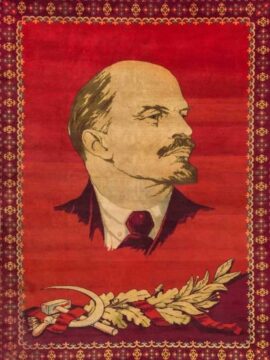
« MATERIALISME ET EMPIRIOCRITICISME ». Ouvrage de Lénine qui inaugure une époque nouvelle dans le développement du matérialisme dialectique. Ecrit en 1908 et publié en 1909, ce livre assura la préparation théorique du parti marxiste de type nouveau.
La raison immédiate qui détermina Lénine à l’écrire fut la nécessité de dénoncer les machistes russes (V. Empiriocriticisme ; Mach) qui, pendant la période de réaction, se dressèrent contre la philosophie marxiste sous couleur de « défendre le marxisme ». Un devoir urgent s’imposait aux marxistes révolutionnaires : infliger une riposte vigoureuse à tous les renégats de la théorie marxiste et sauvegarder les fondements théoriques du parti marxiste.
Lénine s’en acquitta dans son « Matérialisme et empiriocriticisme » qui, d’ailleurs, dépasse de loin cette tâche. Il ne se borne pas à mettre en évidence l’hypocrisie, le caractère réactionnaire des machistes ; il défend et développe les principes théoriques du parti marxiste, généralise tout ce que les sciences, et avant tout les sciences de la nature, avaient acquis d’important pendant toute une période historique, depuis la mort d’Engels.
Modèle de marxisme vivant, cet ouvrage embrasse tous les problèmes de la philosophie marxiste-léniniste.
Dans l’introduction, Lénine montre que toutes les « découvertes » de l’empiriocriticisme et des autres courants réactionnaires ne sont qu’une variante de l’idéalisme subjectif de l’évêque anglais Berkeley (V.). Les trois premiers chapitres exposent à propos de la critique de l’empiriocriticisme les questions fondamentales de la théorie de la connaissance du matérialisme dialectique.
La question de la matière en tant que donnée première et de la conscience en tant que donnée seconde est le point central du premier chapitre. Les machistes affirmaient que les sensations, ou, pour employer leur terminologie, les « éléments », sont donnée première.
Lénine réfute leurs absurdes assertions. A l’opposé de toute espèce d’idéalisme, et en pleine conformité avec les sciences de la nature, le matérialisme envisage la matière comme donnée première, la sensation, la pensée étant donnée seconde.
Toute l’histoire des sciences de la nature confirme la justesse de ce principe fondamental du matérialisme philosophique. Dans ce même chapitre, Lénine développe plus avant les idées d’Engels sur la formation de la matière organique à partir de la matière inorganique.
Dans le deuxième chapitre, Lénine critique l’agnosticisme de Kant (V.), le fidéisme des machistes et justifie la doctrine marxiste de la connaissabilité du monde et de ses lois, de la vérité objective et de la pratique en tant que critère de la vérité.
Il distingue nettement l’agnosticisme et l’idéalisme d’une part, et le matérialisme de l’autre, et met en lumière leur opposition radicale. Comme l’a montré Lénine, l’agnosticisme ne va pas plus loin que les sensations. Il s’arrête en deçà des phénomènes, se refusant avoir quoi que ce soit de certain au-delà des sensations et déclare catégoriquement que nous ne pouvons rien savoir de certain sur les choses.
Sous couleur de critiquer les agnostiques, les machistes niaient les « choses en soi » en général. (V. « Chose en soi » et « chose pour nous ».) Répudiant l’existence des « choses en soi », c’est-à-dire le monde objectif, le monde réel, les machistes affirmaient que seules les sensations constituent la donnée immédiate, et que le monde extérieur est un complexe de sensations.
Dénonçant le socialiste-révolutionnaire Tchernov et d’autres machistes, qui dénaturaient sciemment les conceptions d’Engels, Lénine fait un exposé circonstancié de la théorie marxiste de la connaissance.
Il formule trois conclusions gnoséologiques fondamentales : 1° les choses existent objectivement, indépendamment de notre conscience ; 2° il n’y a aucune différence de principe entre le phénomène et la « chose en soi ». Il n’y a de différence qu’entre ce qui est connu et ce qui ne l’est pas encore ; 3° la connaissance du réel va de l’ignorance au savoir, de la connaissance incomplète, imprécise à la connaissance plus complète et plus précise.
Lénine a donné une définition exhaustive de la matière : « La matière est une catégorie philosophique servant à désigner la réalité objective donnée à l’homme dans ses sensations qui la copient, la photographient, la reflètent, et qui existe indépendamment des sensations » (« Matérialisme et empiriocriticisme », M. 1952, p. 140).
La question de la matérialité du monde et de ses lois est exposée par Lénine de façon détaillée dans le troisième chapitre.
Lénine montre que le charabia terminologique des machistes dissimule l’idéalisme subjectif. Mach écrivait : « Ce que nous appelons matière n’est qu’une certaine liaison régulière entre les éléments (« sensations »). » De cette prémisse idéaliste découlent les autres.
La nécessité, la causalité, le déterminisme, proclamés catégories subjectives, sont ainsi déduits non du monde extérieur, mais de la conscience, de la raison, de la logique. Les conceptions machistes de l’espace et du temps sont également celles de l’idéalisme subjectif. « L’espace et le temps, affirma Mach, sont des systèmes bien coordonnés… de séries de sensations. »
Absurdité évidente, puisque, de cette façon, ce n’est pas l’homme avec ses sensations qui existe dans l’espace et le temps, mais au contraire l’espace et le temps qui existent dans l’homme, dans ses sensations.
Les raisonnements de cette espèce, écrivait Lénine, consacrent l’obscurantisme clérical. « L’idéalisme philosophique n’est qu’une histoire de revenants dissimulée et travestie » (Ibid., p. 205). Du fait qu’on reconnaît l’existence objective de la matière, de la nature, découlent les autres principes matérialistes : reconnaissance du caractère objectif de la causalité et du déterminisme dans la nature, reconnaissance de l’espace et du temps en tant que formes objectives de l’être.
Dans le quatrième chapitre, Lénine étudie l’empiriocriticisme dans son évolution historique, ses rapports avec les autres tendances philosophiques. Il critique en détail les variétés du machisme : l’empiriosymbolisme (V.), l’empiriomonisme (V.), l’école immanente. (V. Ecole immanente en philosophie.) Lénine réserve une place particulière à la critique de l’empiriomonisme de Bogdanov (V.).
Celui-ci considérait comme donnée première le chaos des « éléments » (des sensations), d’où serait née l’expérience psychique des hommes ; vient ensuite l’expérience physique et, enfin, « la connaissance qu’elle engendre ». A l’encontre des subterfuges idéalistes de Bogdanov, Lénine brosse un tableau matérialiste du monde : le monde physique existe indépendamment de la conscience de l’homme et a existé longtemps avant lui ; le psychique, la conscience est le produit supérieur de la matière, la fonction du cerveau humain.
Le cinquième chapitre est consacré à l’analyse de la révolution dans les sciences de la nature et à la critique de l’idéalisme « physique » (V.). Lénine explique tout d’abord les origines de la crise des sciences de la nature Au XIXe siècle, la physique classique avait atteint son apogée. Le matérialisme triomphait dans ce domaine.
Cependant, au seuil du XXe siècle, des découvertes sensationnelles bouleversèrent de fond en comble l’ancien tableau physique du monde. Autrefois, les savants interprétaient les propriétés de la matière dans un sens métaphysique ; les physiciens estimaient que la matière possède des propriétés immuables, données une fois pour toutes (impénétrabilité, inertie, masse, etc.).
Les nouvelles découvertes révélèrent de nouvelles propriétés de la matière : l’électron n’a pas de masse au sens ordinaire, mécanique du mot, sa masse est de nature électromagnétique ; l’atome, qui paraissait être une particule de matière indivisible, s’avéra un phénomène infiniment plus complexe. La découverte de la radioactivité révéla que les éléments considérés immuables se transformaient les uns dans les autres.
Les succès prodigieux des sciences de la nature, les nouvelles découvertes en physique ne pouvaient tenir dans le cadre des anciennes conceptions mécanistes. Pour sortir de cette impasse, les savants devaient se rallier consciemment à la dialectique matérialiste, mais formés dans l’esprit d’une conception du monde idéaliste, beaucoup d’entre eux tirèrent de ces nouvelles découvertes des conclusions idéalistes et affirmèrent que la « matière avait disparu », etc.
On vit surgir parmi les physiciens des écoles idéalistes (idéalisme « physique » d’Ostwald, etc.) qui cherchaient à interpréter dans l’esprit idéaliste les nouvelles acquisitions de la physique. « L’essence de la crise de la physique contemporaine consiste dans le bouleversement des vieilles lois et des principes fondamentaux, dans le rejet de toute réalité objective indépendante de la conscience, c’est-à-dire dans la substitution de l’idéalisme et de l’agnosticisme au matérialisme » (Ibid., pp. 296-297).
Lénine a généralisé les nouvelles découvertes en physique, mis en lumière l’essence de la crise des sciences de la nature, indiqué le moyen d’en sortir par la voie matérialiste, et montré les perspectives illimitées qui s’ouvraient devant elles.
Il a ainsi enrichi le matérialisme philosophique marxiste et lui a donné une forme nouvelle. Lénine a brillamment appliqué la dialectique à la théorie de la connaissance et a développé profondément la théorie marxiste de la connaissance en élucidant nombre de questions essentielles (la théorie du reflet — V., la vérité objective, la vérité absolue et la vérité relative, rapport entre la théorie et la pratique, etc.).
La généralisation qu’a faite Lénine des progrès scientifiques et sa critique du machisme ont à l’heure actuelle une importance considérable pour le développement des sciences de la nature.
L’évolution ultérieure de la physique et des autres sciences a confirmé pleinement l’analyse magistrale de Lénine. La physique contemporaine a fait de nouvelles découvertes qui non seulement prouvent la justesse du matérialisme dialectique mais qui ne peuvent être comprises et expliquées qu’à la lumière des idées exposées dans « Matérialisme et empiriocriticisme ».
Telles sont, par exemple, les découvertes de la physique nucléaire et de la mécanique quantique (V.), etc. Mais les idéalistes « physiques » actuels exploitent ces découvertes pour lutter contre le matérialisme. Selon eux, la libération de l’énergie lors delà désintégration de l’atome signifie la « disparition de la matière », et la transmutation, dans certaines conditions, du photon en couple matériel électron positron et vice versa, équivaut à la création de la matière à partir du « néant », à une « annihilation » de la matière, à sa conversion en énergie « pure ».
La théorie de la relativité (V.) est mise à contribution pour interpréter l’espace et le temps du point de vue de l’idéalisme subjectif, etc. Le livre de Lénine « Matérialisme et empiriocriticisme » arme les savants soviétiques et tous les savants progressistes du monde dans leur lutte contre l’obscurantisme dans la science et dans la philosophie, leur indique la voie à suivre pour atteindre de nouveaux sommets dans le progrès de la science.
Dans le sixième chapitre, Lénine critique l’idéalisme subjectif des machistes dans le domaine social ; il développe et enrichit le matérialisme historique de Marx et d’Engels. Le machiste Bogdanov réduisait la vie sociale à l’activité de la conscience, à l’activité psychique, ce qui aboutissait à l’identification idéaliste de l’existence sociale et de la conscience sociale.
Lénine applique brillamment le matérialisme philosophique à l’étude de la vie sociale, et énonce la formule marxiste du rapport entre l’existence et la conscience sociales. « Le matérialisme admet d’une façon générale que l’être réel objectif (la matière) est indépendant de la conscience, des sensations, de l’expérience humaine.
Le matérialisme historique admet que l’existence sociale est indépendante de la conscience sociale de l’humanité » (Ibid., p. 379). Lénine met en évidence l’esprit de parti en philosophie, soumet à une critique cinglante les tentatives des philosophes bourgeois de s’élever « au-dessus » des principaux partis en lutte sur le terrain philosophique.
Dans la « Conclusion », Lénine résume son exposé : la confrontation des principes théoriques de l’empiriocriticisme et du matérialisme dialectique montre le caractère éminemment réactionnaire du machisme ; les représentants de cette école philosophique sont partis de Kant pour en venir à Hume (V.) et à Berkeley, c’est-à-dire à l’idéalisme subjectif ; le machisme est intimement lié à l’idéalisme « physique » dans les sciences de la nature.
Derrière toutes sortes de subtilités terminologiques il faut savoir déceler les deux courants philosophiques principaux et mettre en lumière la lutte des partis en philosophie.
« Matérialisme et empiriocriticisme » est imprégné d’un bout à l’autre de l’unité rigoureuse des principes, de l’esprit de parti communiste ; il combat avec intransigeance toute velléité de s’écarter du marxisme révolutionnaire.
Chaque parole de Lénine « est un glaive tranchant qui terrasse l’ennemi » (Jdanov). Lénine projette la lumière sur la question de l’esprit de parti en philosophie (V.), stigmatise toute manifestation de tolérance dans la lutte contre le camp idéaliste, toute attitude objectiviste, « sans-parti », en matière de philosophie.
L’ouvrage de Lénine est un modèle de développement créateur de la philosophie marxiste, un modèle de fermeté communiste dans le domaine théorique.
MATERIALISME FRANÇAIS DU XVIIIe SIECLE. V. Matérialisme.